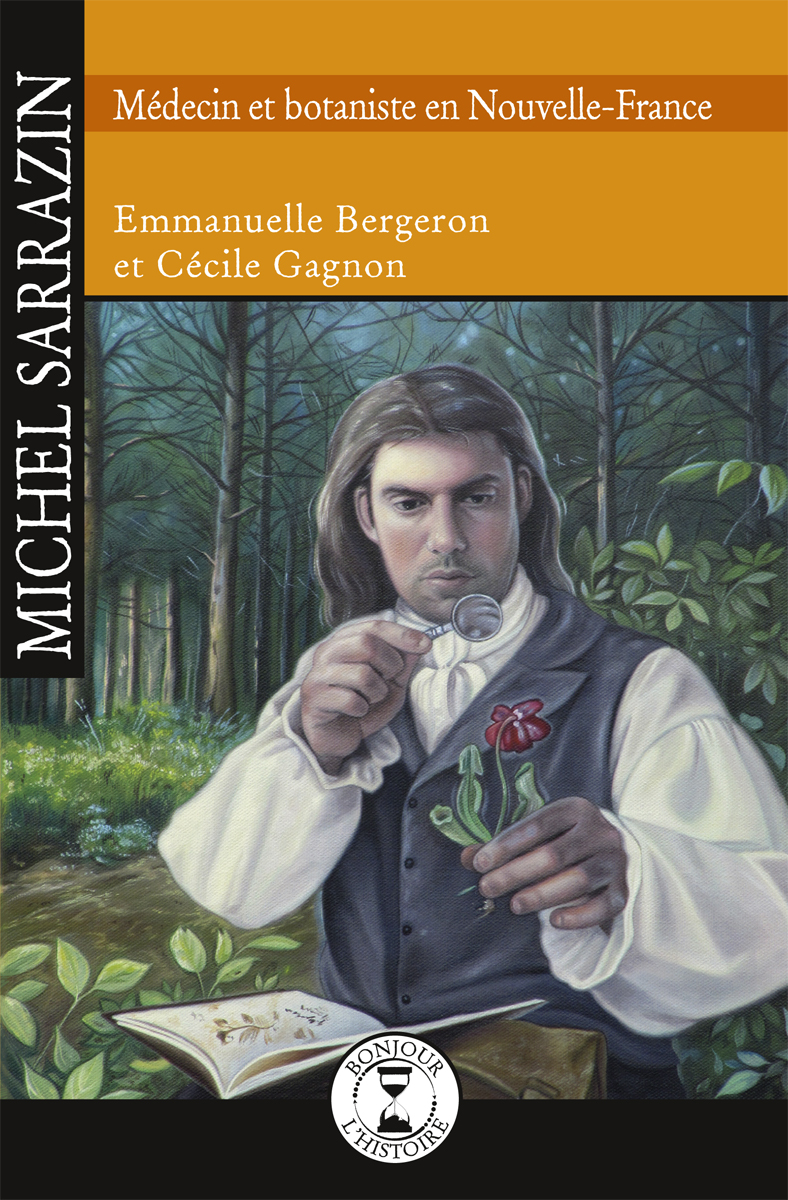- Registre de langue courant dans l’ensemble de l’œuvre; termes identifiés par un astérisque définis dans le glossaire (p. ex., apothicaire, anesthésie, laudanum, tuberculose).
« À cette époque, être chirurgien voulait dire savoir tailler les cheveux et les barbes et panser les blessures en plus d’administrer des potions que préparaient les apothicaires* selon les douleurs ressenties par les malades. » (p. 7)
« En ce temps-là, on ne savait pas faire une anesthésie* pour endormir la douleur que pouvait ressentir la personne qu’on allait opérer. Alors, le docteur Sarrazin fait boire à la patiente […] un mélange de vin et de laudanum*. L’opération est un succès. » (p. 25)
- Structures, types et formes de phrases variés permettant une lecture fluide.
« – Michel, tu vas donc rejoindre les élèves de la Sorbonne? s’enquiert le père Abbé du monastère de Cîteaux, l’ami de son père.
– Que puis-je faire d’autre? se désole le jeune homme.
– C’est très facile : va te faire instruire par un vrai savant, mon ami le Dr Gui Fagon. » (p. 16)
« S’agit-il d’une maladie mortelle? Des taches rouges apparaissent sur la peau des malades. On pense à la fièvre pourprée. Michel en est atteint, mais grâce à son art, il réussit à sauver les malades, l’évêque et lui-même. » (p. 21)
« Il arrive à Québec au moment où sévit une terrible épidémie de fièvre jaune, qu’on appelle "le mal de Siam". Il y a des centaines de morts. » (p. 35)
« Il y joint quelques notes sur la mouffette, mais il doit interrompre ses études à cause de la puanteur exécrable de cette bête! » (p. 39)
« De nombreuses plantes ne survivent pas au voyage par bateau dans les cales humides et sans lumière, puis au transport en charrette jusqu’à Paris. » (p. 40)
- Figures de style peu nombreuses (p. ex., énumération, personnification, métaphore) en raison du genre exploité, la biographie, dont l’intérêt repose sur les faits plutôt que sur le style.
« Il rassemble tout ce qui est nécessaire pour soigner les troupes du marquis. Poudres, huiles essentielles de laurier, de lis et de rose; aussi des bistouris, des seringues, des sirops et des onguents sans oublier les bandages et de vieilles toiles pour servir de pansements. » (p. 9)
« La campagne voisine de la jolie ville de Québec, au bord du fleuve Saint-Laurent, regorge d’une faune et d’une flore toute nouvelle pour lui. » (p. 13)
« Chaque semaine, le nouvel étudiant parcourt les allées du Jardin du Roy à la suite du botaniste pour l’entendre discourir sur les propriétés des plantes, des plus exotiques aux plus simples, comme le bouton d’or ou la marguerite. Il boit ses paroles. » (p. 17)
« Dans son souvenir, le beau visage de Marie-Anne Hazeur revient souvent et son cœur se serre à la pensée qu’elle a peut-être convolé en justes noces pendant sa longue absence. » (p. 34)
- Séquences narratives et descriptives accentuant la curiosité, la passion, le dévouement et la détermination de Michel Sarrazin.
« Durant toute son enfance […] il a accompagné son père pour cueillir des plantes. Avec lui, il a développé l’art de distinguer les herbes utiles, les plantes qui donnent des démangeaisons comme les orties, et celles qui ont des propriétés purgatives. Il a gardé ce goût d’herboriser* et sa curiosité lui a déjà fait découvrir quelques nouveautés en cette terre de Canada. Il se dit qu’il retrouvera avec joie cette passion des plantes lors de ce nouveau voyage. » (p. 10)
« En vrai curieux, Michel profite de ces moments pour observer tout ce qui l’entoure, les arbres, les plantes et les bêtes qu’il croise. Il reporte ses observations dans son cahier. » (p. 11)
« Il fait aménager la maison selon ses besoins : le rez-de-chaussée garde une place privilégiée pour les herbiers et les boîtes vitrées contenant toutes sortes d’insectes. Il s’y trouve même des cages pour y mettre des animaux vivants. Il y a des rayonnages pour les livres et une table de dissection*. Dans le jardin, le docteur fait transplanter des herbes et des plants repiqués des berges du fleuve et des forêts voisines. » (p. 27-28)
« Malgré la soixantaine avancée, Sarrazin est toujours aussi actif et entreprenant. On peut le voir marcher dans la campagne, accompagné de son fils aîné qu’il veut initier aux merveilles curatives des plantes […] Toute sa vie, le docteur Sarrazin se tient au courant des progrès de la science. Grâce à ses amitiés avec les scientifiques français, il poursuit ses expériences sur la guérison de certaines maladies résistantes. » (p. 41)
- Quelques séquences dialoguées permettant au lectorat d’apprécier la détermination de Michel Sarrazin et de mieux comprendre l’interaction entre les personnages.
« Lors d’une rencontre dans une auberge avec de jeunes hommes comme lui, son ami Louis Jolliet lui dit :
– Michel, pourquoi n’iriez-vous pas en France parfaire vos études et devenir médecin? Vous savez combien l’absence d’un médecin ici, en Nouvelle-France, nous pèse.
Les autres convives se mettent de la partie.
– En effet, Michel, nous aurions bien besoin de vous, déclare son ami Franquelin, le cartographe.
Le jeune homme se sent interpellé. Il proteste :
– Mais j’aime ce pays! J’aime Québec.
– Vous aurez ici un piètre avenir en tant que simple chirurgien, poursuit Jean-Baptiste Franquelin.
– Pensez-y, répète son ami Jolliet. Vous reviendrez avec un diplôme de médecin. Et vous serez mieux estimé en plus de sauver des vies. » (p. 13)
« – Monsieur l’Intendant, implore-t-il, le mal arrive des navires. Je vous prie d’instaurer une quarantaine pour les bateaux arrivant à Québec.
– Je n’ai encore reçu aucun ordre de Paris pour obliger les capitaines à suivre vos judicieux conseils.
– Alors nous continuerons à souffrir de maladies incurables*! s’emporte le médecin. Selon l’évêque, les seuls remèdes à ces fléaux sont les prières et les pénitences. Foutaise! » (p. 22)
« – Charles, viens voir! crie-t-il.
– Ah! je connais cette plante. Ici on l’appelle oreille de cochon! s’exclame le Huron.
– On l’utilise pour soigner?
– Certainement. Chez les miens, on en tire un remède pour guérir ce que vous appelez la petite vérole. » (p. 23)
« – Faites venir des ânes par le prochain navire de La Rochelle, insiste-t-il. Vous verrez combien ce sera utile.
– Vous ne trouvez pas, monsieur le docteur, que votre demande est plutôt exagérée? s’écrie l’un des membres.
– Si vous étiez atteint de tuberculose, monsieur, répond Sarrazin d’un ton sans réplique, vous seriez certainement d’accord. » (p. 42)