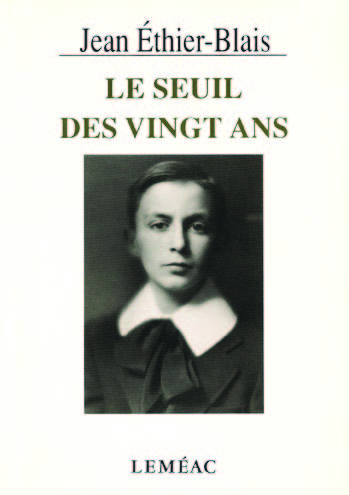Le seuil des vingt ans
Dans ce second tome de ses mémoires, Jean Éthier-Blais brosse avec passion un grand portrait de la vie des collèges classiques de 1938 à 1946, alors que l’enseignement des humanités proposait encore aux élèves une poétique de la vie. Ce portrait devient vite un chant d’amour pour ce lieu des apprentissages multiples que, jeune élève, il fit dans ce collège des jésuites de Sudbury, en Ontario, au moment où François Hertel était professeur en Belles-Lettres. Il rencontra dans ce milieu pourtant fermé les beautés de la culture et de la civilisation occidentales : littérature, musique, religion, théâtre, mais aussi politique, nationalisme, amours, amitiés. Tous ces ferments contribuèrent au développement d’une vocation passionnée pour cette culture qui allait fortement, entre toutes, inspirer son œuvre littéraire et critique.
(Tiré de la quatrième de couverture du livre.)