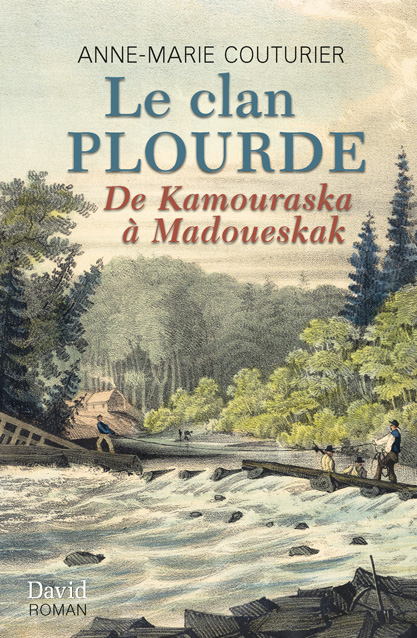- Trois personnages principaux, appartenant à des générations différentes, mais descendant tous d’un même ancêtre, René III de Plour, dit le Mousquetaire.
« Pierre se retrouvait soudainement à la tête d’une fratrie démembrée, à remettre sur ses rails dans cette vallée champêtre du Bas-Saint-Laurent. Tel était son rôle, à présent. Tracé par un sort désobligeant, s’il en est, mais où persisterait une manière d’être Plourde qui ne céderait en rien à la fatalité. Un tempérament qui s’étendrait au-delà des siècles, Pierre à René en tête. » (p. 71)
« Premier de famille et premier en tout, Pierre Dupérré allait le demeurer tout au long de son existence de célibataire.
Toutes choses devaient aboutir avec lui. » (p. 160)
« Pendant que les deux fils de Marie-Louise à Augustin à René travaillaient d’arrache-pied à la colonisation de Madoueskak, d’autres petits-cousins naissaient et grandissaient sur les terres ancestrales du Bas-Saint-Laurent. En 1825, l’un d’entre eux, Pierre-Auguste Plourde, vint, à l’instar de ses réputés cousins, travailler au développement de ce coin de pays. » (p. 229)
- Nombreux personnages secondaires, parmi lesquels Hekko, Marie-Louise et Lizotte, dont l’importance tient à leur relation avec les divers chefs de famille et au rôle qu’ils jouent dans le déroulement de cette saga historique.
« Hekko, sortie de la même souche que le pionnier. Arrière-petite-fille du Mousquetaire comme René, son arrière-petit-fils. Une nouvelle tige sur le même pied, à une quarantaine d’années d’intervalle. Une toute petite métisse… » (p. 143)
« Tellement fière, la Marie-Louise, de ses deux rejetons qui retournaient à la colonisation comme son grand-père René. Quant à elle-même, elle assurait dans ce jeune pays la transmission des coffres centenaires de l’héritage familial. » (p. 183)
« …Lizotte, dès le lendemain, partit seul s’entraîner avec la milice. Malgré son insondable peine, il ne laisserait jamais tomber le combat entrepris par son aîné afin que les leurs ne soient plus jamais déracinés. » (p. 211)
- Narrateur omniscient rapportant les événements et compatissant à la douleur des personnages.
« Dans cette foulée dévastatrice, malgré les directives reçues la veille et malgré la victoire acquise, 140 maisons de plus, dans le coin de l’Anse-à-Gilles, s’envolèrent en fumée. […]
Une semaine pour créer le monde? Pas plus de huit jours pour l’anéantir. Pour réduire en fumée l’espoir. Pour carboniser 150 ans de coups de collier sur les bords d’un grand fleuve, où plus de 1 100 habitations passèrent au bûcher. […]
Fournaise infernale éteinte, les mères et leur marmaille commencèrent à sortir du fond des bois. Un tel anéantissement!
Pourquoi ces femmes avaient-elles donné la vie? » (p. 114-115)
- Nombreuses prolepses, transportant le lectorat dans les rêves d’avenir des bâtisseurs de la Nouvelle-France.
« Même cette part d’héritage qu’il venait d’embellir de dépendances ne représentait qu’une petite partie de ses projets d’avenir. Il n’était pas encore marié, mais il se voyait debout au milieu d’une ribambelle d’enfants comme d’une dynastie dont il meublerait les champs tout autour. » (p. 73)
« Pour se réserver de vastes espaces, les nouveaux colons, par groupuscules, s’éloignèrent de 10 à 15 milles les uns des autres. Ainsi, quand les enfants grandiraient, ils s’installeraient à proximité de leurs parents. […]
"Et surtout, on deviendrait rapidement propriétaire. Pour la première fois de sa vie! "
Les autorités l’avaient promis! » (p. 176)