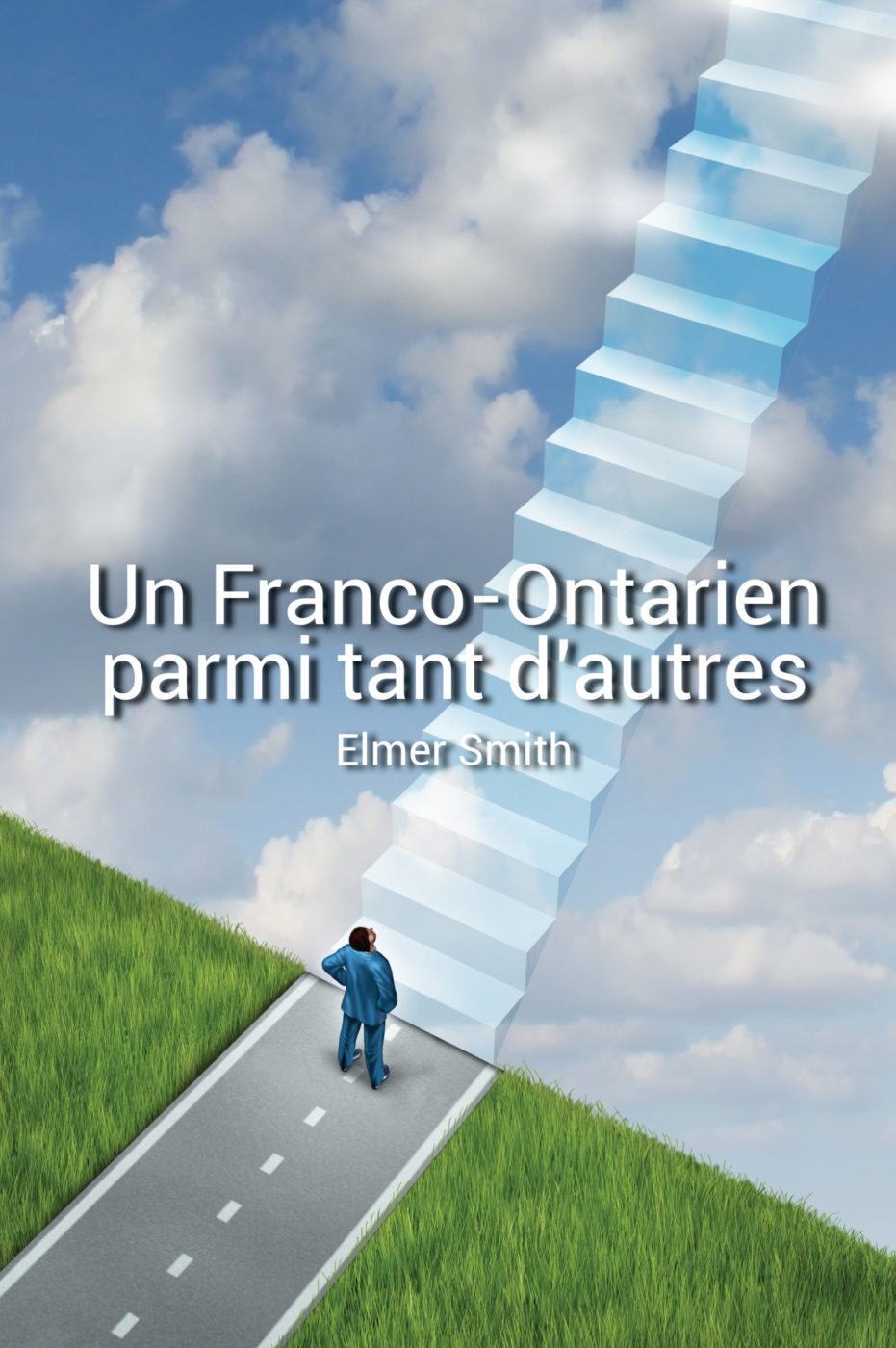- Essai exposant les états d’âme d’un auteur octogénaire à la recherche de soi et du vrai Dieu dans la société franco-ontarienne de son époque
« …la genèse de mon questionnement sur mon identité et sur le sens de la vie était liée à la peur de vivre et la culpabilité engendrées par le dogme et l’idéologie religieuse catholique romaine […] Leur emprise sur moi, dont j’ai réussi à me déprendre sur le tard, fut également la résultante de mon hypersensibilité et des autres facteurs déjà mentionnés, savoir mon appartenance à la classe ouvrière et mon état de minoritaire franco-ontarien… » (p. 17)
« À mon grand désarroi, en matière de Dieu et du sens de la vie sinon d’appartenance à l’Église, on m’avait réduit au rang de l’homme esclave de ses habitudes : j’étais né pour manger, avoir mes mouvements réguliers, travailler, jouer une partie de golf occasionnelle et gagner le Ciel fermé par Dieu au moment de la pomme dans l’arbre et rouvert par un Messie crucifié. » (p. 32)
« Le Franco-ontarien ne pouvait se définir sans qu’on précise d’abord, sinon remette en question, ses liens avec son Église. La langue, la culture et la Foi formaient un tout aux éléments inséparables. Or ceux-ci avaient considérablement évolué, leur influence respective aussi. D’une part on s’anglicisait et d’autre part les fidèles avaient récupéré leur droit de se questionner sur les dogmes de leur Église. Le temps était donc venu de me situer à mon tour. » (p. 59)
- Discours alternant entre faits et réflexions philosophiques, entre affirmations et questions, entre constatations et doutes.
« Au-delà de ce qu’on avait toujours dit de moi : que j’étais un Canadien français ou plus tard un Franco-Ontarien, catholique, fils d’Aldémard et de Clarice, éduqué par les Jésuites, puis un jour devenu avocat et enfin magistrat, – qui étais-je vraiment sous la pelure? » (p. 25)
« Laisse le champ libre à ceux qui s’y connaissent en la matière en t’en tenant à ceux qui te conforteront dans ta foi d’antan. Il se fait tard, garde ta liberté pour autre chose. Peu te chaut qu’ils te répètent les mêmes leçons, les mêmes vieilles rengaines sous les apparences d’un langage de la modernité. Tu refuseras d’entendre en ton for intérieur ce qui ne te convient plus et tu te débrouilleras avec ce qui restera. » (p. 31)
« Cette Église était l’ancre qui permettait à mon identité minoritaire de survivre et de s’affirmer tout en voguant sur cet océan anglais où je risquais à tout moment de faire naufrage et de disparaître. Elle me sécurisait donc tout en comblant le manque d’amour vrai dans ma vie. Le cri de ralliement "la langue et la foi", ces deux inséparables dont on nous avait tant rebattu les oreilles, faisait partie de notre être. » (p. 62)
« Étais-je moi-même plus avancé pour m’être si souvent enquis du pourquoi de l’existence face à ce mal envahisseur, radical et sans répit, dont était frappée l’humanité? Les réponses à mes questions m’échappaient comme elles avaient échappé aux intellectuels de tous les temps. » (p. 81)
« Tantôt c’était mon cœur qui parlait et tantôt ma raison, le premier encore un peu croyant et la deuxième sur le point de rejeter Dieu sans réserve. » (p. 85)
« Je penchais du côté de l’existence de Dieu parce que je préférais qu’il y eût un Dieu pour assurer ma légitimité et le sens de l’Univers. […] Pour ma part, je m’inscrivais toujours du côté de l’existence de Dieu, tout en doutant de cette même existence. » (p. 91)
- Séquences narratives dans lesquelles l’auteur traite de sujets qui tantôt le rassurent, tantôt l’aiguillonnent (p. ex., enfance, langue, politique, histoire, religion).
« Mon enfance s’écoula de façon heureuse dans une petite ville du Nord ontarien. Nous parlions français tout le temps grâce à l’Église et à la petite école. Je vivais avec beaucoup d’intensité, assuré d’être chéri de Dieu. Insouciant, ricaneur et espiègle, muni d’une prodigieuse mémoire, j’accueillais la vie à bras ouverts, ne me doutant même pas qu’il puisse y avoir une vérité envisageable hors de mon Église et de mon milieu culturel. » (p. 19)
« Nous des régions plus au nord de la province, étions davantage à la merci de l’Anglais qui nous procurait nos chances d’avancement, donc plus prompts à lui lécher les bottes afin d’être élus au conseil municipal. Il en résultait que les Franco-Ontariens d’Ottawa, dans l’ensemble plus sûrs d’eux-mêmes, nous regardaient de haut et étaient plus tranchés dans leur discours à l’encontre du Québécois qui voulait son pays. » (p. 40)
« Prélude de ce néolibéralisme à la Thatcher, devenu la coqueluche des gens d’affaires et d’un nombre grandissant de politiciens de toutes couleurs, la common law, annonciatrice des théories dites lucides des Conrad Black de ce monde, avait développé les règles qui assuraient la protection des institutions en place, lesquelles favorisaient d’abord les nantis. » (p. 50)
« La social-démocratie était une gangrène à combattre par tous les moyens et on collait, comme un vice à honnir, l’épithète de libéral à ses adversaires pour gagner la faveur du peuple qu’on avait déjà embrigadé dans la guerre sainte contre les libéraux, les démocrates, les socialistes et les communistes, bref les méchants, les ennemis de l’État ou plutôt du peuple, et par conséquent, ennemis de Dieu. » (p. 55)
« Les chicanes de clocher et de pouvoir avaient éclaté dès l’ascension de son fondateur, opposant d’abord Pierre et Jacques de Jérusalem à Paul l’apôtre des gentils, puis les théologiens et évêques des 2e, 3e et 4e siècles du christianisme d’Église, tantôt ceux d’Antioche qui s’en prenaient à ceux de Carthage ou d’Alexandrie, et tantôt ceux de Jérusalem ou de Rome qui combattaient leurs frères d’Antioche. » (p. 61)