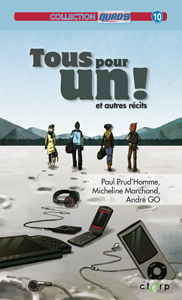Contenu
- Personnages principaux, des adolescents et adolescentes, différents dans chaque récit (p. ex., Zac et sa sœur Louise, leurs amis Alexa et Claude dans Tous pour un!, Nathaniel et son cousin Sasha dans Les prisonniers de la vague, et Zoé dans Zoé et le flambeau olympique), vivant des aventures extraordinaires, tous faisant preuve de courage et d’ingéniosité lorsqu’ils se voient confrontés à des défis de taille; personnages secondaires aidants (p. ex., le grand-père, les parents, le frère aîné Rémi, l’ermite vietnamien).
« – Dis-le, Grand-papa!
– Viendriez-vous dans mon avion de brousse, à mon camp de chasse au lac Kirba, dans le Grand Nord de l’Ontario?
– Euh… toute la semaine? demande Louise.
– On partirait dimanche matin pour revenir le samedi suivant. Le grand air, le ski de fond, la raquette, la chasse, la trappe, enfin des vacances toutes autres que celles passées ici, à Ottawa!
Les jeunes se regardent, pensent la même chose. Louise, plus impulsive, lance :
– Moi avec mon chum et Zac avec sa « blonde »? demande-t-elle en regardant son grand-père d’un air ratoureux. » (p. 6)
« Elle lève les yeux vers le nuage, puis vers la baie. « Où sont Nathaniel et Sacha? »
Les garçons, qui se prélassent dans le canot pneumatique, ne remarquent pas le changement soudain dans la force et la direction du vent. Ils rient en sentant l’agitation de la vague. La brise du sud-est a poussé leur embarcation vers le large. Nathaniel, le premier, remarque la grande distance qui les sépare de la berge. Les garçons tentent d’abord d’attirer l’attention en s’époumonant. » (p. 41)
« Quel soulagement! La flamme olympique était éteinte, mais le flambeau était en parfaite condition. Il restait tout de même un espoir à la paix.
– Merci beaucoup, je m’appelle Zoé, je dois absolument retourner le plus vite possible chez moi, on m’attend, la flamme, le relais du flambeau, le symbole, les Jeux olympiques, la paix entre les peuples…
[…]
– Je m’appelle Tao. J’ai quitté mon pays, le Vietnam, il y a longtemps pour enfin vivre en paix au Canada. La forêt me permet d’avoir la paix… » (p. 67-68)
- Trois courts récits d’aventure, truffés de rebondissements, chacun permettant au lectorat de créer des liens avec ses expériences personnelles (p. ex., semaine de relâche au mois de mars, vacances estivales, festivités reliées aux Jeux olympiques); thèmes exploités (p. ex., aventure en plein air, mésaventure en canot, joueuse de hockey, amitié, courage, suspense) aptes à intéresser le lectorat visé.
- Illustration pleine page précédant chaque récit; illustrations en noir et blanc, dans les deux derniers récits, permettant d’établir un lien direct avec le texte et servant d’appui à la compréhension de la lecture.
- Texte généralement pleine page; éléments graphiques (p. ex., guillemets, tirets, points de suspension, italiques, astérisques indiquant un changement de lieu et de temps, motifs reliés à la thématique de chaque œuvre agrémentant les bas de page) facilitant l’interprétation de l’œuvre; table des matières au début; courtes biographies des trois auteurs sur la quatrième de couverture.
Langue
- Registre de langue courant dans l’ensemble de l’œuvre; mots moins connus (p. ex., réanimation cardiorespiratoire, nimbostratus, cafard, ambassadrice) et quelques expressions populaires (p. ex., mes petits choux, itou, mon chum, sa blonde) compréhensibles grâce au contexte.
- Variété de figures syntaxiques (p. ex., phrases déclaratives, exclamatives, impératives et interrogatives, positives et négatives) qui contribuent à la lisibilité du texte et donnent du rythme à la lecture.
« Mais l’hélicoptère poursuit sa route. Quelques instants plus tard, l’appareil revient. Nathaniel, déterminé à attirer l’attention des secouristes, se met debout dans le canot. Ce mouvement brusque lui fait perdre l’équilibre. Il tombe à l’eau. Paniqués, les garçons voient le faisceau de lumière s’éloigner d’eux, et bientôt ils n’entendent plus le bruit de l’hélicoptère. » (p. 46)
« – Alors, bien dormi? me demanda-t-il.
– Où suis-je? répondis-je en me relevant difficilement pour m’asseoir sur le bord du lit. Aïe! J’avais si mal à la tête et Brrr, si froid.
– Approche-toi du feu, tes vêtements ne sont pas encore secs. Je t’ai trouvé sur la glace il y a une dizaine de minutes. Tu étais au bord de l’hypothermie. » (p. 67)
- Nombreuses figures de style, surtout dans le premier récit, (p. ex., énumérations, comparaisons, métaphores, personnifications, onomatopées) qui enrichissent le texte et ajoutent de la vraisemblance à l’œuvre.
« – J’ai dormi comme une marmotte, dit Zac… Me suis pas réveillé une seule fois.
– J’ai vu ça : tu ronfles comme une tondeuse! » (p. 16)
« Chaque jeune se retrouve seul avec ses pensées. Et pendant un long moment, on n’entend que le bourdonnement du moteur.
– Huum… huum… » (p. 30)
- Séquences descriptives entrecoupées de nombreuses séquences dialoguées, apportant des précisions sur les personnages, les lieux, les événements et les émotions et permettant de mieux comprendre les relations entre les personnages.
« Tous écoutent Zac en hochant la tête affirmativement.
– L’avion est la seule façon d’amener le malade à l’hôpital…
– Mais personne ne sait piloter, et l’émetteur-récepteur est brisé! Tu t’en souviens? lance Louise.
– Oui, mais… j’ai souvent volé avec Grand-papa. Je l’ai observé, je lui ai posé beaucoup de questions et demandé beaucoup de renseignements. Une fois, Grand-papa, assis à mes côtés, m’a laissé piloter pendant quelques minutes.
On commence à comprendre. Doute, peur, mais aussi espérance.
Alexa réfléchit froidement et demande :
– Tu saurais décoller et atterrir?
– Est-ce qu’on a une autre façon de sauver la vie de mon grand-père?
Son visage crispé exprime une telle urgence que les autres commencent à espérer que ce soit possible. » (p. 28)
« Soudain, les nuages déversent leur charge sur eux. Heureusement, le déluge se termine aussi rapidement qu’il a commencé. Peu à peu, les vents s’essoufflent et les eaux se calment. Les marins, épuisés, trempés jusqu’aux os et transis, se laissent voguer sur l’onde. L’orage terminé, les nuages cèdent leur place au soleil couchant. » (p. 45)
« On m’a expliqué une dernière fois ce que je devais faire, alors qu’un porteur arrivait avec la flamme olympique. Je faillis perdre connaissance : c’était Sydney Crosby, mon idole! Il s’avançait vers moi, comme flottant sur un nuage, même si la tempête de neige redoublait d’ardeur. Il me remit le flambeau olympique, effleurant mes doigts. Malgré le froid, mon visage s’empourpra, et j’eus soudainement chaud au cœur. Probablement parce que je savais que je transportais un puissant symbole de paix. » (p. 64)
Référent(s) culturel(s)
- Mentions de référents de la francophonie ontarienne, surtout dans le premier récit : lieux géographiques (p. ex., hôpital Notre-Dame à Hearst, p. 35), expressions langagières (p. ex., son chum, p. 5, « itou », p. 15), coutumes et traditions (p. ex., camp de chasse, raquette, trappe).
Pistes d'exploitation
- Inviter les élèves à choisir un extrait du roman les ayant particulièrement touchés, puis à en faire la lecture devant le groupe-classe.
- Dans chaque récit, les personnages principaux vivent des aventures dangereuses. Animer une table ronde sur les questions suivantes : Quelle mésaventure est arrivée dans le récit? Est-ce que les personnages auraient pu prévenir le danger? Comment? De quelles façons les personnages ont-ils résolu leurs problèmes? Êtes-vous d’accord avec les stratégies choisies?
- En groupe-classe, animer une discussion sur la question suivante : Pourquoi est-ce important de connaître les interventions en situation de crise (p. ex., demeurer calme, appeler le 911, connaître l’emplacement du défibrillateur). Inviter un moniteur de RCR à venir faire une démonstration de la méthode RCR (réanimation cardiorespiratoire) aux élèves.
- Demander aux élèves, réunis en dyades, de situer les lieux mentionnés dans les trois récits sur une carte de l’Ontario, puis d’effectuer une recherche afin de trouver la population de chacune de ces villes. Animer une discussion en groupe-classe afin d’expliquer les raisons pour lesquelles les villes du sud de l’Ontario ont une plus grande densité de population que celles du nord.
Conseils d'utilisation
- Animer une discussion sur l’importance de prendre des décisions judicieuses pour son bien-être et celui des autres.
- Présenter ou revoir les règles de la table ronde.
- Inciter les élèves à lire d’autres recueils de récits, tels que De plein fouet! et autres récits, La course folle et autres récits et Le berger du soleil et autres récits, dont les fiches pédagogiques se trouvent dans FousDeLire.
Ressource(s) additionnelle(s)
- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 5e à 12e année, Série : Opération Aïe, Épisode 9.