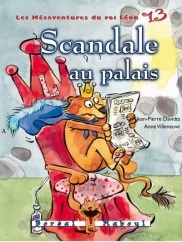Contenu
- Personnage principal, le roi Léon, lion sympathique et célèbre, se trouvant aux prises avec le rédacteur en chef d’un journal à potins qui ne cesse d’imprimer des articles malencontreux à son sujet; personnages secondaires, le corbeau Niman, rédacteur en chef du journal Feuille de chou, le Grand Chambellan, serviteur et complice de Sa Majesté, Dame Papircoûle, la Grande Institutrice, bien-aimée du roi, le gorille Maître Alé, chef cuisinier du royaume, ainsi que les employés du journal, le rat Contar, son papa Razi et le calmar Chopa.
« – Qui est l’auteur de ce torchon? rugit le roi en brandissant sa Feuille de chou. Un corbeau vola jusqu’à lui.
– Bonjour, Majesté. Mon nom est Niman. Je suis le rédacteur en chef. Que nous vaut l’honneur de votre visite? » (p. 13)
« Le Grand Chambellan plongea dans une profonde réflexion.
– Il faudrait que le journal colporte des mensonges.
– Mais il le fait déjà!
– C’est vrai, seulement les animaux croient le contraire. Si les mensonges étaient plus gros, ils s’en apercevraient mieux et arrêteraient de lire le journal. Écoutez, j’ai un plan. Voici comment nous allons procéder. » (p. 35-36)
« Le roi avait l’air si malheureux sur la photo que Dame Papircoûle eut un élan de tendresse. Elle se maquilla en vitesse pour aller le réconforter en personne.
Jamais elle ne saurait que ce numéro de la Feuille de chou n’avait été tiré qu’à un seul exemplaire : celui que le roi Léon avait déposé devant sa porte durant la nuit! » (p. 50)
- Intrigue cocasse, riche en rebondissements, permettant au lectorat de se divertir tout en se renseignant au sujet du journalisme; œuvre teintée d’humour et de subtilités, faisant valoir l’importance d’exercer un esprit critique face à la lecture de textes publiés; sujets aptes à soutenir l’intérêt du lectorat tout au long du récit (p. ex., humour, situations cocasses et embarrassantes, influence des médias, honnêteté, droits et libertés, journalisme).
- Nombreuses illustrations en noir et blanc, parfois petites, parfois pleine page; scènes caricaturales révélant les émotions ressenties par les personnages et représentant quelques moments stratégiques de l’intrigue.
- Mise en page aérée; texte organisé en huit courts chapitres numérotés et titrés; éléments graphiques (p. ex., lexique en bas de page, majuscules, guillemets, tirets, italiques) qui facilitent l’interprétation du texte.
Langue
- Registre de langue courant dans l’ensemble de l’œuvre; mots et expressions moins connus (p. ex., guingois, tantinet, moribond, inepties, mine de rien) compréhensibles à l’aide du contexte.
- Utilisation de phrases de base, de phrases transformées et de phrases à construction particulière, de types et de formes variés, contribuant à la lisibilité de l’œuvre et permettant une lecture dynamique.
« Le roi ne décolérait pas.
– Quel est le misérable qui a fait ça?
– J’ai mené ma petite enquête, Sire, répondit le Grand Chambellan. Le journal est imprimé ici même. Dans les caves du palais.
– Dites-moi où. J’y vais immédiatement. » (p. 11)
« Le roi sourit. Enfin quelqu’un de raisonnable!
– Bien sûr, mon brave Alé, répondit-il. Que voulez-vous savoir?
– Eh bien voilà. J’ai quelques difficultés avec ma guenon ces temps-ci. Alors, vous qui connaissez bien les félines…
– Je-Ne-Les-Con-Nais-Pas! tempêta le roi en tapant du poing sur la table. » (p. 31-32)
- Emploi de nombreux procédés stylistiques (p. ex., calembour, onomatopée, comparaison, expression imagée, énumération) qui enrichissent le texte, permettant au lectorat d’apprécier le style humoristique de l’auteur.
« – Cet article! Qui vous a autorisé à le publier?
– La liberté de presse, Sire.
– Lally Berthé Depraisse? Qui est cette dame? Je veux lui parler sur-le-champ. » (p. 13-14)
« La main de la Grande Institutrice fit résonner le mot « clac! » sur la figure du roi Léon. » (p. 22)
« Les habitants du palais étaient parfaitement ridicules : nus comme des vers et trempés comme des soupes1. » (p. 43)
« Sa crinière était tout ébouriffée, sa cape était sale et chiffonnée, et sa couronne avait besoin d’être astiquée. » (p. 49)
- Séquences descriptives, qui prennent souvent la forme de tribunes dans le journal Feuille de chou, permettant au lectorat de se situer dans le temps et le lieu de l’action; nombreuses séquences dialoguées, permettant de s’imaginer la scène et les personnages.
« Le numéro suivant paraîtrait le soir même. Le roi avait hâte de le lire. Quand il le déroula, la première chose qu’il vit fut sa photo. C’était une très belle photo. Il souriait de tous ses crocs et sa couronne était bien droite. Puis le roi lut le titre de l’article : « DÉCLARATION D’AMOUR DU ROI LÉON ». Et, en plus petits caractères, le sous-titre : « J’aime la Grande Institutrice, proclame notre monarque. » » (p. 17 et 19)
« Quand la Feuille de chou suivante arriva, le roi Léon était un tantinet nerveux. Il la déroula en tremblant.
Cette fois, il n’y avait pas de photo de lui. Seulement une de Dame Papircoûle et une autre de la belle Lurette. Sous la première, on lisait : « Le roi est libre d’aimer qui il veut. » Et sous la seconde : « Il n’a jamais aimé que moi. » En guise de titre, l’article posait une question : « LE ROI LÉON, UN LION À FÉLINES ? » » (p. 29)
« Du jour au lendemain, le tirage1 de la Feuille de chou tomba de plusieurs milliers d’exemplaires à quelques-uns seulement. Plus personne ne voulait en lires les articles. Il n’y avait rien de vrai là-dedans. Rien que des racontars et des exagérations. Privé de lecteurs, le journal ferma ses portes au bout d’une semaine. » (p. 47)
Pistes d'exploitation
- Demander aux élèves, réunis en dyades, de rédiger une entrevue dans laquelle un élève joue le rôle d’un journaliste et l’autre, le roi Léon. Leur rappeler l’importance de rédiger des questions ouvertes et des réponses élaborées, qui permettront aux auditeurs de mieux comprendre le personnage du roi. Inviter les équipes à répéter leur entrevue et à la présenter au groupe-classe.
- En groupe-classe, lire aux élèves la section Est-ce vrai? aux pages 53 et 54 de l’œuvre. Animer une discussion traitant des situations du récit qui portent atteinte aux droits et aux libertés de la personne (p. ex., le corbeau Niman, qui rapporte malhonnêtement l’information, le roi Léon, qui essaie de censurer l’information, le caméraman, qui prend, sans permission, des photos dans un endroit privé). Demander aux élèves d’exprimer leur opinion sur les journaux à sensation qui présentent des articles de façon exagérée pour attirer l’attention des lecteurs.
- En groupe-classe, demander aux élèves d’identifier les divers types de médias. Leur demander, regroupés en dyades, d’identifier, dans un tableau en T, l’influence positive des médias (p. ex., accès à l’information, liberté d’expression) et ses effets négatifs (p. ex., exposition à la violence, déformation de l’information). Animer une mise en commun afin de permettre à chaque équipe de présenter les points saillants de sa discussion au groupe-classe.
- Le style de l’auteur comprend l’utilisation de calembours et d’expressions figurées. Demander aux élèves, regroupés en dyades, de relever certaines de ces expressions dans l’œuvre et d’en expliquer le sens (p. ex., le titre du chapitre 6 est Allô Peau lisse; il existe un vrai journal à potins nommé Allô Police.). Animer une mise en commun afin de permettre aux élèves de faire part de leur travail au groupe-classe.
- Inviter les élèves, regroupés en dyades, à créer le schéma de la une d’un journal, en nommant les différentes zones qui la composent (p. ex., manchette, tribune, sous-tribune, ventre). Afficher les créations dans la salle de classe.
Conseils d'utilisation
- Inviter un journaliste à venir parler de son travail aux élèves ou organiser une visite aux installations du journal local.
- Avant la lecture, lire aux élèves la courte description du roi Léon sur le rabat de la deuxième de couverture.
- Encourager les élèves à lire d’autres œuvres traitant de la liberté d’expression, telles que La Démocratie, j’aime ça! et La Démocratie, je l’invente!, dont les fiches pédagogiques se trouvent dans FousDeLire.
Ressource(s) additionnelle(s)
- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 4e à 10e année, Série : Active-toi, L’intimidation; Médias responsables.
- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 4e à 6e année, Série : Justice, Moutarde et Cornichons, La liberté d’expression.
- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 1re à 6e année, Série : 1 Jour 1 Question, C’est quoi la liberté d’expression?
- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 1re à 12e année, Série : Français sans frontières, Toi, consommateur de médias.