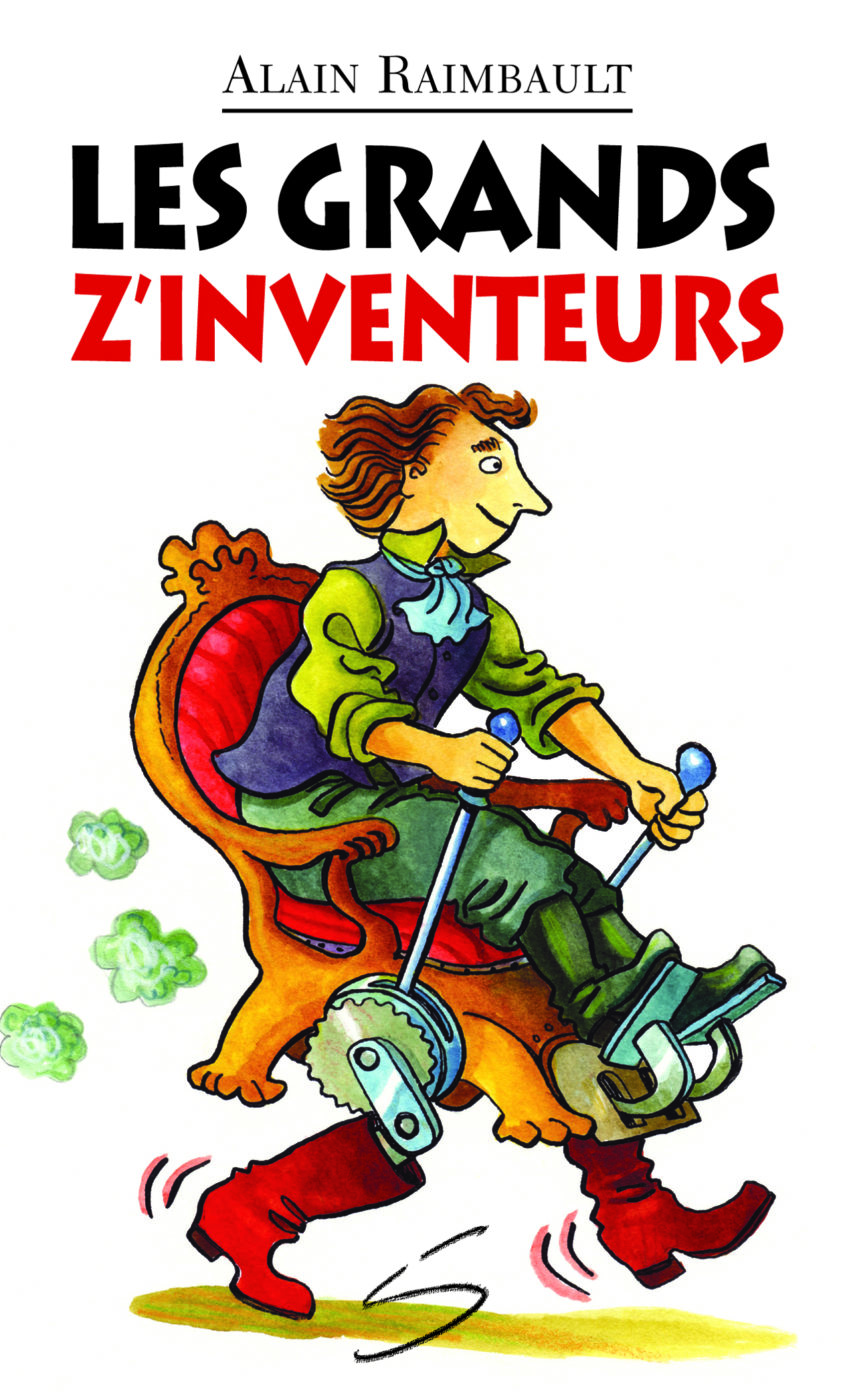Contenu
- Œuvre présentant avec originalité les exploits de 29 inventeurs de renom ayant vécu entre le 15e et le 20e siècle; poèmes en vers libres, généralement avec rimes, contenant un nombre varié de vers et de strophes.
« Gutenberg inventa la presse à bras
parce qu’avec les pieds,
il n’y arrivait pas.
En effet, il était très fatigué
de recopier toute la journée
et à la main
de vieux textes en latin
sur de gros parchemins.
Gutenberg avait mal aux reins! » (p. 10)
- Texte qui saura plaire au lectorat visé par les thèmes abordés et le style imagé et humoristique de l’auteur; poèmes permettant d’apprendre des faits intéressants sur chaque inventeur et de piquer la curiosité des élèves, les incitant possiblement à poursuivre la recherche.
- Texte aéré accompagné d’illustrations en noir et blanc qui établissent des liens avec les personnages; propos de l’auteur et de l’illustratrice à la fin de l’œuvre de même qu’une table des matières; présence d’éléments graphiques facilitant l’interprétation de l’œuvre (p. ex., caractères gras, parenthèses, guillemets).
Langue
- Registre de langue courant dans l’ensemble de l’œuvre; plusieurs mots nouveaux que le contexte permet de définir (p. ex., galopin, aérostat, pare-buffle, vulcanisation, bourrelier, usurpateurs); structures de phrases variées, disposées en vers, apportant du dynamisme à la lecture.
- Emploi de métaphores, de comparaisons et d’expressions figurées qui permettent d’apprécier le style de l’auteur et qui contribuent à la richesse du texte.
« Les carnets dans ses tiroirs
souvent écrits à l’envers
pour percer les mystères
du grand univers
ont besoin de miroir
pour parler à l’endroit. » (p. 12)
« Armé de sa lorgnette
et d’un bâton,
l’astronome eut du mal à prouver
qu’il avait raison.
Jugé coupable comme une sorcière,
l’Église le fit taire. » (p. 15)
« Grâce à lui, désormais, les opérés,
bien au chaud
dans les bras de Morphée,
cessèrent de pousser
des hurlements
quand on les découpait joyeusement
au bistouri. Aïe!
(Quelle horreur!) » (p. 48-50)
Référent(s) culturel(s)
- Présentation d’inventeurs français dont Denis Papin, Joseph-Ignace Guillotin, Les frères Montgolfier, Nicéphore Niepce, Frédéric Sauvage, Louis Braille, Eugène-René Poubelle, Alexandre Gustave Eiffel, Clément Ader, Constantin Senlecq, les frères Lumière, et un Québecois, Joseph-Armand Bombardier.
Pistes d'exploitation
- Proposer aux élèves, réunis en dyades, de choisir leur poème préféré, puis d’effectuer une recherche pour se renseigner sur l’inventeur. Leur demander de présenter leurs trouvailles au groupe-classe sous la forme d’une affiche en prenant soin de décrire les répercussions d’une telle invention sur la vie des gens à l’époque et aujourd’hui.
- À la fin de l’œuvre, le mot de l’illustratrice Caroline Merola incite le lectorat à concevoir des inventions farfelues (p. ex., le paressographe, une machine à dessiner sans se fatiguer). Suggérer aux élèves, regroupés en équipes, de concevoir une invention farfelue, puis de la présenter au groupe-classe.
- Inviter les élèves à choisir dans le recueil un poème qu’ils ont particulièrement apprécié, puis à expliquer les raisons de leur choix au groupe-classe en tissant des liens avec leur vécu.
- En groupe-classe, noter les inventions récentes populaires chez les élèves. Leur suggérer, réunis en dyades, d’en choisir une, puis de rédiger une annonce publicitaire pour la mettre en valeur. Les inviter à présenter leur annonce devant les autres élèves de l’école.
Conseils d'utilisation
- Le recueil présente uniquement des inventeurs masculins. Expliquer l’absence d’inventrices à l’aide du mot de l’auteur, à la fin de l’œuvre, qui explique ses choix en raison des rôles définis des hommes et des femmes à l’époque des inventeurs qu’il a choisis. Il fait mention de quelques femmes de renommée, dont Marie Curie, Marguerite Yourcenar, Charlotte Brontë, Joséphine de Beauharnais, et de femmes d’aujourd’hui, la reine Élizabeth et Julie Payette. Offrir le choix aux élèves d’effectuer leur recherche sur une inventrice ou sur l’un des inventeurs présentés dans le recueil.
- Présenter les caractéristiques de l’affiche et de l’annonce publicitaire.
- Inciter les élèves à lire d’autres œuvres du même auteur, telles que Petits bonheurs, Le soufflé de mon père et Dodo, les canards!, dont les fiches pédagogiques se trouvent dans FousDeLire.
Ressource(s) additionnelle(s)
- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 1re à 6e année, Série : Savais-tu que…, divers épisodes.
- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 4e à 6e année, Série : Vraiment Top!, divers épisodes.
- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 2e à 12e année, Série : Comment ça marche?, divers épisodes.