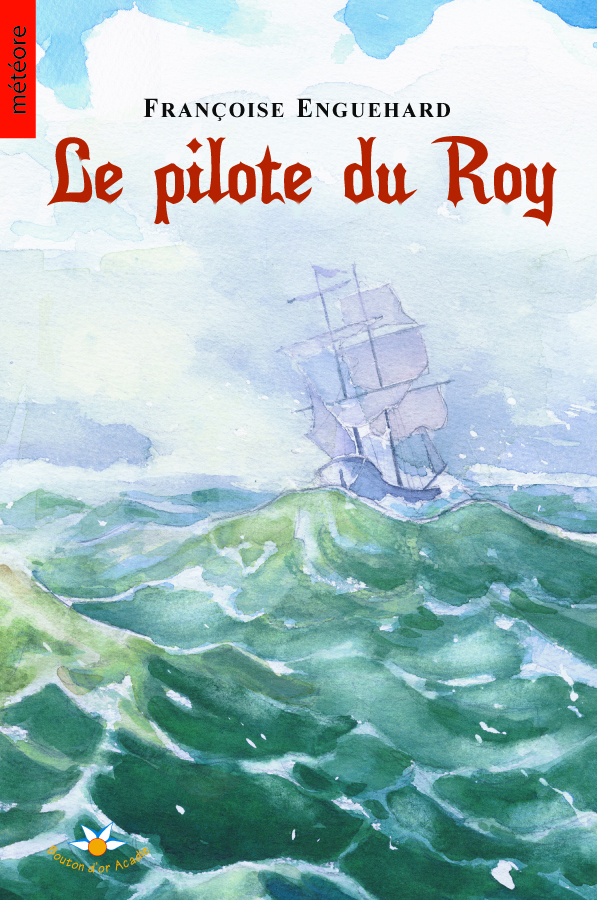Contenu
- Personnages principaux, Xavier Sire, pilote du Roy, et son fils Alexandre, garçon âgé de 13 ans, qui l’accompagne au cours d’une aventure dangereuse en mer.
« Xavier Sire occupe, en effet, les fonctions de pilote du Roy. C’est lui qui guide les navires jusque dans le Barachois de Saint-Pierre et les amène jusqu’au quai, rôle important qu’on lui a confié parce qu’il connaît les eaux tout autour de l’île comme un cultivateur connaît ses champs. » (p. 10)
« Alexandre l’entend à peine, son esprit est déjà là-bas, au quai, où est amarrée la chaloupe du pilote. Son père l’embarquera, sans doute, pour aller chercher le navire dans la passe du Suet. Leste, le jeune homme n’a pas son pareil pour lancer l’amarre et sauter à bord des navires. » (p. 15)
« Quelques jours plus tard, Xavier Sire rejoint son fils sur le pont.
[…]
– Père, croyez-vous qu’on va bientôt arriver en France?
[…]
Le pilote ne veut pas trop en dire pour ne pas inquiéter son fils, mais il est d’avis qu’un malheur guette. » (p. 63)
- Personnages secondaires, les hommes qui accompagnent Xavier Sire au cours du trajet périlleux, le capitaine Bozec, responsable de la Laure, navire provenant de la France, Victoire, l’amie d’Alexandre, qui croit fermement qu’il ne périra pas en mer, et Fayolle, le commandant de la colonie Saint-Pierre.
« Quelques minutes plus tard, la chaloupe du pilote s’éloigne péniblement de la cale. À son bord ont pris place Alexandre – il est à l’avant de façon à jeter l’amarre à bord du brick –, son père, le pilote, Jules Portanguen, patron de la chaloupe, ses deux matelots, Hervois et Hoguais, et le gendarme Yreux, arrivé alors que l’embarcation s’apprêtait à quitter la cale de débarquement.
[…]
Tout juste derrière la pointe, le capitaine Bozec attend impatiemment son guide pour gagner l’abri du Barachois. Comme tout son équipage, il ne rêve que de lancer les amarres et de se trouver à quai. » (p. 21)
« Victoire, elle, n’y croit pas. La Laure reviendra, elle en est certaine. Il lui semble que si Alexandre s’était noyé, elle l’aurait senti. Voilà plus d’un an qu’ils sont inséparables, que l’un finit les phrases de l’autre, qu’elle devine ses humeurs et lui les siennes. Non, répète-t-elle à qui veut l’entendre, ils reviendront. » (p. 55)
« Le commandant Fayolle convoque aussitôt le capitaine du navire granvillais.
– Quelqu’un chez vous a-t-il eu des nouvelles de la Laure?
Personne en Normandie n’a entendu parler de la tragédie. Et le chef de la colonie s’en veut une fois encore d’avoir envoyé le gendarme à sa perte. » (p. 69)
- Roman historique qui propulse le lectorat dans une aventure périlleuse en mer; intrigue riche en péripéties tenant le lectorat en haleine du début à la fin; histoire alternant entre le trajet risqué des marins à bord de la Laure et la vie des habitants de la colonie Saint-Pierre s’inquiétant de la survie des membres de l’équipage; dates parsemées dans le texte contribuant à la vraisemblance de l’histoire; thèmes exploités (p. ex., aventure, colonie, navigation, danger) aptes à capter l’intérêt du lectorat visé.
- Mise en page aérée; œuvre répartie en neuf chapitres numérotés; éléments graphiques (p. ex., tirets, italiques, guillemets, points de suspension, notes de pied de page) facilitant l’interprétation du texte; remerciements et dédicace au début du livre; note historique et renseignements sur l’auteure à la fin.
Langue
- Registre de langue courant dans l’ensemble de l’œuvre; mots moins connus (p. ex., lorgnette, leste, encablures, tonitruante, culer) et mots reliés au thème principal de la navigation (p. ex., sémaphore, brick, cales, bâbord, tribord, coque) généralement compréhensibles grâce au contexte et aux renseignements fournis.
- Phrases transformées et phrases à construction particulière; variété de types et de formes de phrases (p. ex., déclarative, exclamative, impérative, impersonnelle, négative); phrases généralement longues.
« Tout le monde attend son signal.
– Raidissez!
C’est maintenant ou jamais… Le brick, écartelé par le vent violent d’un côté et le poids de son ancre de l’autre, tente de s’immobiliser. Cette lutte entre la Laure et les éléments déchaînés dure un instant qui semble pourtant une éternité aux yeux des hommes impuissants. Et la nature l’emporte : la chaîne perd de sa raideur – l’ancre n’a pas tenu – et le navire se met de nouveau à reculer devant les vagues. Cette fois, il faut se remettre dos au vent et fuir.
– Y aura pas de Saint-Pierre ce soir, les gars, conclut Jules Portanguen, le patron de la chaloupe du pilote. » (p. 32)
- Procédés stylistiques (p. ex., énumération, expression imagée, comparaison, personnification, métaphore, interjection) qui enrichissent le texte.
« Grâce au jardinier Meuzy, les champs de la grande île ont produit une abondance de pommes de terre, poireaux, carottes et choux qui permettent à la colonie tout entière d’envisager sereinement les longs mois d’hiver. » (p. 19-20)
« – Vivement le plancher des vaches! s’écrie un vieux marin. » (p. 26)
« Comme dans un ballet, le navire tourne, se couche, se raidit, mais il obéit. » (p. 31)
« Une énorme main invisible semble la pousser vers le large de plus en plus vite. » (p. 33)
« – Assez! intervient Xavier Sire. Le capitaine a pris sa décision. » (p. 52)
- Séquences narratives et descriptives, entrecoupées de séquences dialoguées, qui fournissent des informations sur une époque particulière, permettent de s’immiscer dans l’esprit des personnages et traduisent les dangers mortels auxquels font face les marins.
« « Le manque de pain de qualité », avait expliqué le commandant Fayolle, responsable de la colonie, dans une de ses longues lettres de doléances aux autorités françaises, « met en péril la survie de nos colons ». Il en voulait pour preuve que le four construit à la hâte à Miquelon s’était effondré et que le boulanger de l’île Saint-Pierre faisait du pain « si exécrable » que même les habitants ayant droit au secours du Roy « se plaignent amèrement ». Au printemps 1821, Yvan Bénard, père de Victoire, boulanger de son état à Nantes, avait pris ses fonctions à Saint-Pierre, fortement influencé dans sa décision par son épouse, fille d’Acadiens réfugiés en France en 1778 qui voulait « rentrer au pays ». (p. 11-12)
« « Pourvu que le foc tienne bon », se dit le capitaine Bozec. Ce tout petit bout de toile les préserve, pour l’instant, du pire. Si la voile venait à se déchirer sous les assauts du vent…
« J’ai fait tout mon possible, il reste plus qu’à prier », conclut intérieurement Xavier Sire qui, tout à coup, n’a qu’un souci.
– Alexandre? Alexandre? » (33-34)
« Averti du drame, le commandant Fayolle s’est levé de son fauteuil comme si une guêpe l’avait piqué et il arpente la salle comme un possédé.
– Comment ça, « disparu »? Enfin, Leroy… Vous me dites que la Laure était dans la rade et qu’elle a disparu?
– Il fait très mauvais dehors, Monsieur le Commandant. Juste au moment où le navire entrait, le vent a pris au noroît – vent de côté – et ils ont rien pu faire d’autre à bord que d’affaler les voiles et de fuir devant la tempête.
– Et quelles sont les chances qu’ils reviennent?
– Si le capitaine réussit à trouver un abri dans une baie de Terre-Neuve, on les verra revenir dès que la tempête sera passée.
– Sinon?… Sinon, pas la peine de me faire un dessin… Un autre navire perdu corps et biens. » (p. 38-39)
Référent(s) culturel(s)
- Histoire se déroulant simultanément à Saint-Pierre-et-Miquelon, un archipel français d’Amérique du Nord, et à bord de la Laure, un voilier français.
- Mention de la ville de Nantes et de la Normandie, situées en France.
- Mention de la Saint-Sylvestre, fête célébrant à la fois la fin de l’année en cours et le Nouvel An.
- Allusions aux déportations de familles acadiennes.
- « Fils de Jean Cyr et de Marguerite Dugas, Acadiens de Chédabouctou réfugiés à Saint-Pierre pour la première fois en 1767, Xavier Sire est né à Saint-Pierre et y a grandi avant d’être par deux fois déporté, avec sa famille, vers la France. » (p. 10)
Pistes d'exploitation
- Avant la lecture, suggérer aux élèves, réunis en équipes, d’effectuer une recherche sur les caractéristiques du roman historique (p. ex., œuvre mêlant la réalité et la fiction, histoire inventée ayant lieu à une époque qui a existé, mélange de personnages fictifs et de personnages réels). Les inviter à faire part de leurs trouvailles au groupe-classe, puis à en dresser une liste au tableau. À la suite de la lecture du roman, animer une discussion en se référant à ces caractéristiques afin de déterminer si Le pilote du Roy est un roman historique.
- Au cours de la lecture, dresser, en groupe-classe, une liste des personnages mentionnés dans le roman. À la suite de la lecture de l’œuvre, suggérer aux élèves, regroupés en dyades, d’effectuer une recherche en vue de découvrir si certains de ces personnages ont réellement existé. Les inviter à faire part de leurs découvertes au groupe-classe, en prenant soin de fournir des preuves concrètes à l’appui (p. ex., Jean Cyr et Marguerite Dugas (p. 10), nés en 1736, mariés en 1763, en Acadie). Lire, en groupe-classe, la note historique à la fin du roman, qui fournit des renseignements au sujet des personnages.
- Former neuf équipes, puis leur assigner un chapitre du roman. Leur proposer de relever les indices qui révèlent l’époque à laquelle se déroule l’histoire (p. ex., Chapitre 1 : Toute la colonie de l’île Saint-Pierre attend le dernier navire de la saison, qui leur apporte des vivres. Les filles n’ont pas le droit de fréquenter l’école.) Les inviter à faire part de leurs trouvailles au groupe-classe.
- Demander aux élèves de noter, au cours de la lecture, les mots reliés au thème de la navigation. Après la lecture de chaque chapitre, définir, en groupe-classe, les mots relevés, puis les ajouter à un mur de mots. À la suite de la lecture du roman, proposer aux élèves, réunis en équipes, d’utiliser les mots et les définitions pour créer un jeu de mots croisés, puis les inviter à offrir les jeux à des élèves du cycle moyen.
Conseils d'utilisation
- Accorder une attention particulière au sujet délicat de la consommation d’alcool, dont on traite dans le roman.
- Situer les îles Saint-Pierre et Miquelon sur une carte géographique.
- Faire remarquer aux élèves que le mot « Roy » est la graphie de l’ancien français pour le mot « Roi ».
- Encourager les élèves à lire un autre roman de la même auteure, soit Le trésor d’Elvis Bozec, dont la fiche pédagogique se trouve dans FousDeLire.
Ressource(s) additionnelle(s)
- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 4e à 12e année, Série : À la conquête des mondes, À la conquête des océans.