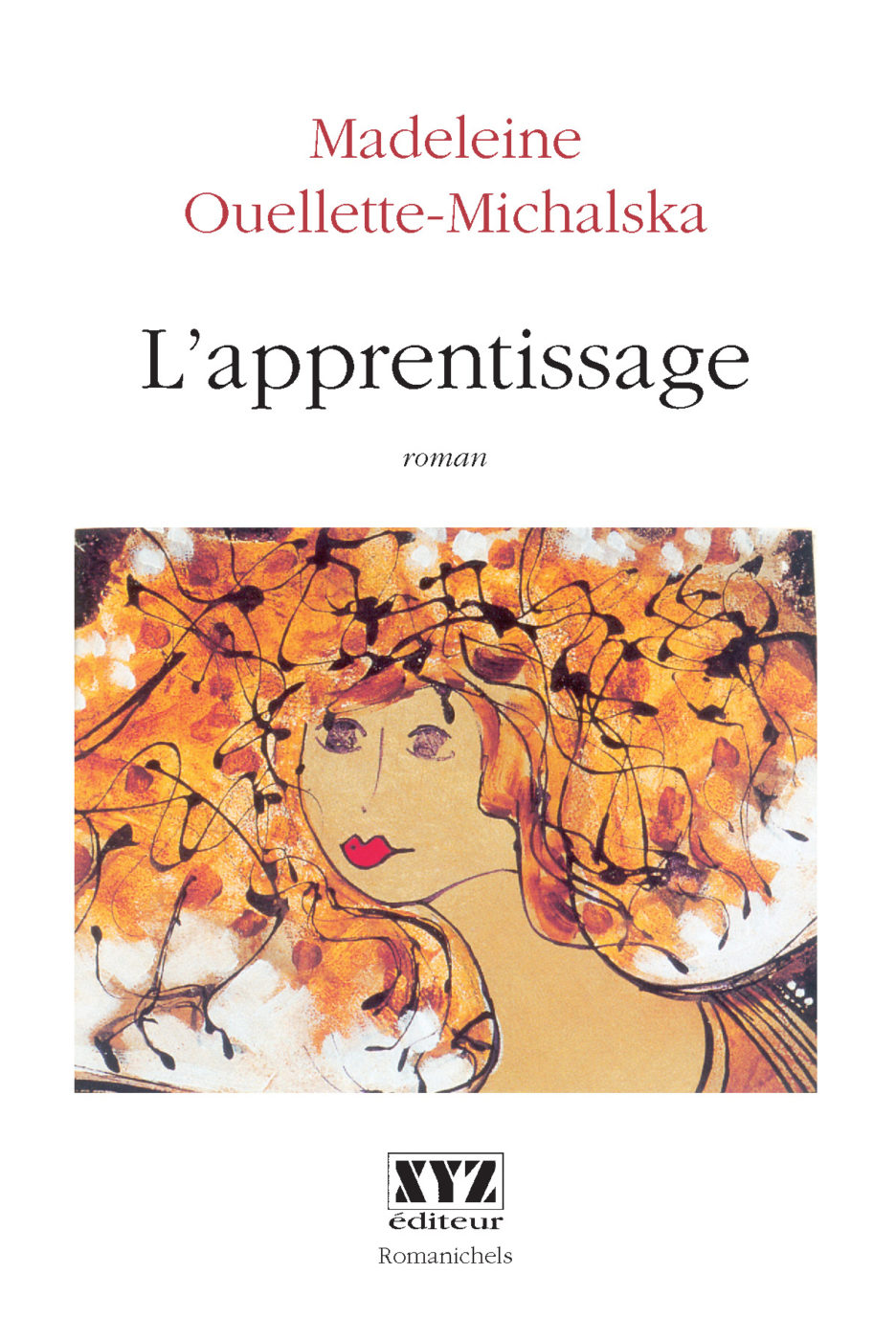- Intrigue en six chapitres, contenant des présages, de nombreuses ellipses et des retours en arrière permettant de suivre et de comprendre l'histoire d'une vie.
« Elle ignore qu'un jour les mots lui permettront d'accomplir ce que le dessin lui refuse : rendre autrement et à sa manière une réalité qu'elle ne se contentera plus d'imiter. » (p. 34)
« Quelques mois plus tard, elle reviendra dans cette pièce, les mains vides. Elle marchera droit vers la photographie récente, nue et sans cadre, prise une semaine plus tôt chez la photographe du village. » (p. 56)
« Elle se met à écrire plus vite, craignant de voir fuir l’instant, sa plénitude, une jouissance que rien d’autre ne saurait remplacer. À six ans, elle éprouvait déjà cette sensation lorsqu’elle traçait son nom, avec une pierre bien aiguisée, sur une strate d’ardoise trouvée en bas des rochers. » (p. 120)
- Héroïne anonyme (p. ex., l'enfant, l'adolescente, l'écrivaine), rêveuse et en quête d'identité, présentée depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte.
« L’enfant appuie sa main sur sa bouche et serre les lèvres. Elle veut grandir, connaître l’amour, non s’engouffrer dans un monde de réalités violentes qui saccageraient ses rêves. » (p. 38)
« Face aux trésors enfouis dans le tiroir ouvert, l'adolescente se demande si, plus tard, lorsqu'elle ne sera plus là, une main attentive viendra palper un objet, un bijou lui ayant appartenu. Elle aimerait que l'on se souvienne d'elle, de ses goûts, des vêtements qu'elle aura portés un soir de tristesse ou de triomphe. » (p. 46)
« Peu après son arrivée dans la ville, le directeur du journal local lui cède une page hebdomadaire qu’elle remplira à sa guise. Elle sera libre de publier des entrevues, des poèmes, des comptes rendus de conférences et même un courrier du cœur. » (p. 71)
« Malgré l’acuité du souvenir, l’écrivain sera saisie d’un doute lorsqu’elle écrira ce passage. Aurait-elle inventé la scène à partir des récits de la mère, ou répété une histoire qui lui aurait été racontée? » (p. 104)
- Personnages secondaires (p. ex., mère, père, cousins et L., mari de la protagoniste), observés par l'héroïne et contribuant directement ou indirectement à sa vision du monde.
« Une fois la crise traversée, […] la mère reconnaît la lourdeur de l'héritage reçu. Elle évoque l'ampleur des charges familiales, les frais encourus pour chacun des frères et sœurs dont le père avait la responsabilité. Elle comprend cependant mal sa déception d’avoir dû renoncer aux études commencées à Lowell. Après tout, elle-même a déjà été institutrice, et ça ne l’a pas empêchée de partager la vie de la belle-famille, de supporter ses exigences et ses caprices. » (p. 18)
« L’anglais restera pour elle la langue du père à demi absent, l’homme inatteignable qui n’habite jamais complètement le domaine familial. » (p. 20)
« En quittant l'armée, le cousin se fiance à une riche et séduisante héritière qu'il laisse languir pendant quatre ans avant de la quitter. […] L'homme au front dégarni représente l'indépendance, la connaissance des vieux pays. […] Pour l'adolescente, son visage restera associé aux amours faciles, aux photos de marins publiées dans les journaux, aux résistances que la conscription soulevait dans les villages. » (p. 89-90)
« L. laisse à la jeune mère l'entière responsabilité de l'enfant dès qu'il n'exige plus de biberon avant l'aube. Elle insiste pour qu'il se rende près du berceau qu'il n'approcherait pas autrement. Peut-être craint-il cet enfant qui appelle à lui tout son savoir, excède tout ce qu'il pourrait en dire. » (p. 114)
- Narratrice omnisciente exposant les réflexions, les désirs et les sentiments de la protagoniste au fil du temps.
« Mais l'enfant n'a pas encore découvert que l'enfance est un lieu bien avant d'être une époque. Elle sait néanmoins que l'été favorise le lointain, son déploiement, alors que l'hiver impose le règne du proche, le repli au fond des murs derrière lesquels siffle le vent. » (p. 29)
« Elle veut l'amour, mais pas d'enfants, du moins pas tout de suite. Les femmes enceintes et joufflues, gorgées de semence, de nourriture, ne lui font pas envie. Elle leur préfère les jeunes filles libres et audacieuses des magazines de mode, celles-là ne s'engouffreront pas trop vite dans la tranquille béatitude du mariage. Et puis, rien ne presse. Devenir mère sans avoir été femme lui paraît une abomination. » (p. 45-46)
« Dès qu'elle voit l'enfant, elle oublie tout. Sa frayeur, sa souffrance, sa fatigue sont derrière elle. Lorsqu'on la ramène à sa chambre, un grand bien-être l'envahit, l'ivresse comme après le danger. » (p. 113)
- Thèmes nombreux (p. ex., temps, amour, écriture, condition de la femme) reflétant le périple existentiel du personnage principal; sujets délicats de la mort et des limites sociales chez la femme, s'intégrant vraisemblablement au quotidien des personnages.
« Elle ignore encore jusqu’à quel point ce visage, auquel elle trouve un grand nombre d’imperfections, deviendra rapidement méconnaissable à ses propres yeux. Car le temps se déplace rapidement, même si parfois elle le croit immobile. À peine est-on l’enfant des albums de famille que l’on sourit bientôt à ses propres enfants devenus grands. » (p. 57)
« Décès du père un jour ensoleillé d’octobre. Il part vite, emporté par un cancer auquel personne n’a cru lorsqu’il en souhaitait la venue ou en déclarait les symptômes. » (p. 59)
« Solliciter l’opinion des femmes sur la pollution, l’environnement, est jugé déplacé par la direction. » (p. 92)
« Elle a hâte que se termine leur lune de miel.
Sa vie amoureuse ne ressemble à celle d'aucune héroïne des grands romans déjà lus. » (p. 107)
« Derrière son livre, la jeune femme dissimule une feuille sur laquelle elle écrit. L’abandon du corps au dossier de la chaise longue facilite la venue de ce qu’elle veut écrire. Les phrases se suivent sans réflexion ni préméditation. Le rythme, ou peut-être même le sens, semble venir des mots eux-mêmes. » (p. 119-120)
« Comme d’autres femmes avant elle, elle cède à la manducation. Elle se laisse dévorer par les rituels domestiques, accorde sa préférence aux repas, au ménage, aux lessives, aux factures qui l’appellent. Sans le savoir, elle se dévore elle-même. » (p. 126)
- Texte entièrement constitué de séquences descriptives et narratives, abondant en indices socioculturels de la société évoquée (p. ex., mode de vie, pratiques religieuses, valeurs).
« Avec ses sœurs, elle retrouvera la cohue grouillante de la sortie, le modeste attelage, les rires sur les trottoirs. Aucun homme de la maison ne sera dans la voiture. Ils préfèrent marcher la distance qui sépare la propriété des chics résidences du village. » (p. 33)
« Le sacrement leur est administré dans une église colossale et glacée où la douzaine d’invités, éparpillés dans les premiers rangs, font figure de figurants dans un théâtre oublié. En franchissant la nef, la fiancée est prise d’un vertige. » (p. 106)
« L'hôtesse écoute à peine. Ce qui a toujours été tenu secret dans son milieu, par pudeur ou ignorance, est maintenant divulgué comme une recette de gâteau au chocolat ou une soupe aux artichauts. Elle a toujours cru que mieux valait laisser la sexualité s'épanouir en son propre mystère. » (p. 110)