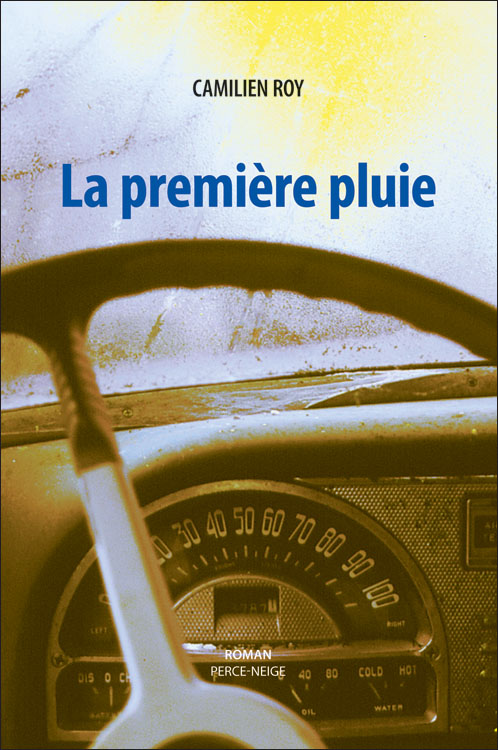La première pluie
Quitter sa famille et son village pour la première fois; surmonter toutes les difficultés et les angoisses; faire le deuil de son adolescence : voici l’histoire d’un jeune Acadien qui a quitté son village pour faire la récolte du tabac en Ontario dans les années 1970. D’inspiration moderne dans son style et son contenu, ce récit à la première personne, à la fois roman d’initiation et roman de la route, mise davantage sur l’évolution intérieure du personnage et sur la finesse de l’observation que sur l’abondance et l’éclat des péripéties.
(Tiré de la quatrième de couverture du livre.)