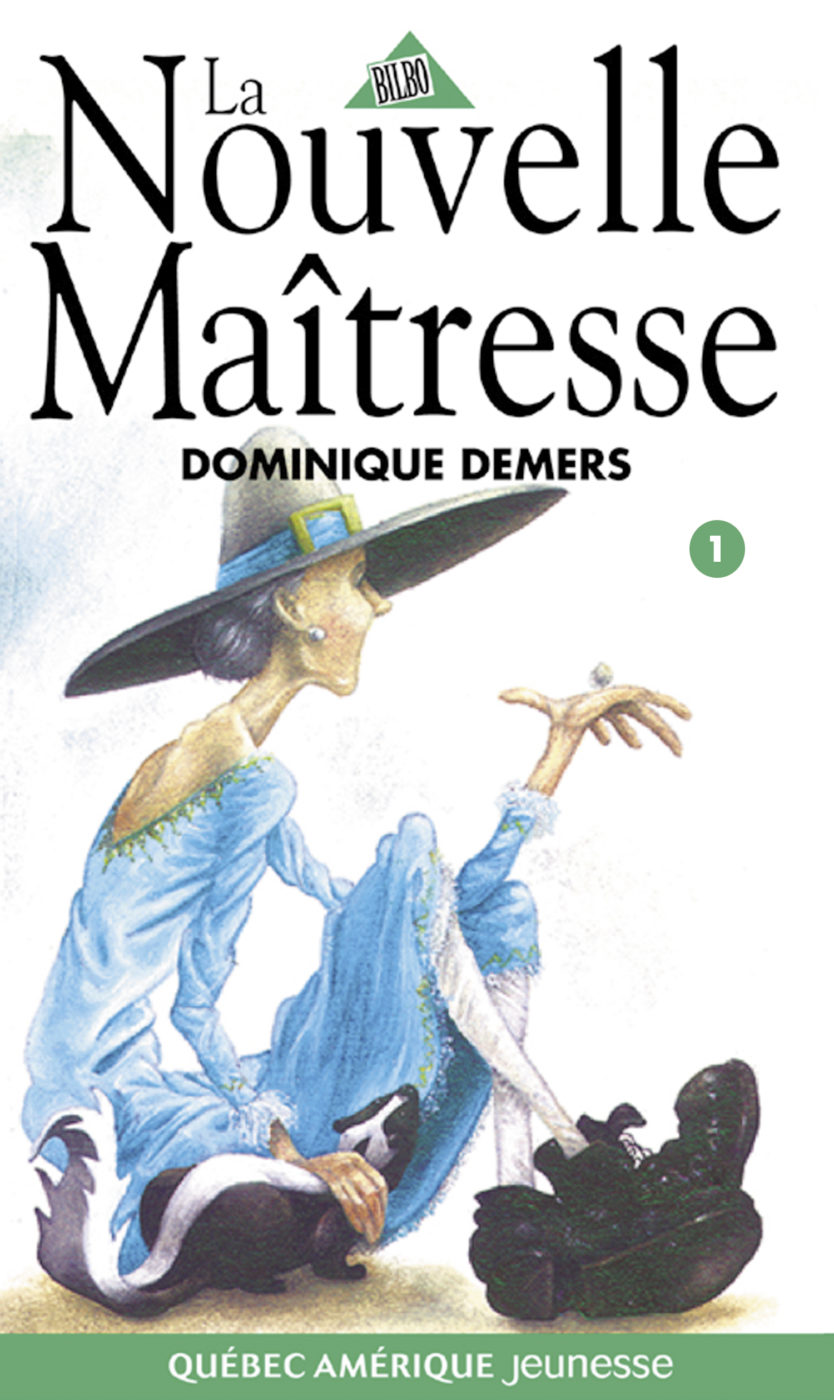Contenu
- Deux personnages principaux, Mademoiselle Charlotte, nouvelle enseignante qui captive ses élèves avec ses manières extravagantes mais attachantes, et la narratrice du roman, une jeune fille qui raconte les aventures vécues au sein de sa classe; plusieurs personnages secondaires, dont le directeur M. Laporte, surnommé M. Cracpote, qui remet en question les méthodes d’enseignement de Mlle Charlotte, Gertrude, le caillou confident de Mlle Charlotte, ainsi que plusieurs élèves de la classe, dont Charles-Antoine Gabriel-Bédard, Mario Tremblay, Mathieu Bérubé, et Josée Lachance.
« Ses cheveux gris étaient ramassés en chignon. Elle était coiffée comme bien des vieilles dames mais, sur sa tête, il y avait un objet étrange. De la taille, disons, d’une clémentine, d’une balle de golf ou d’une grosse gomme casse-gueule. Plusieurs élèves se sont levés pour mieux voir et Philippe est carrément monté sur son pupitre.
C’était un caillou. Une roche! » (p. 15-16)
« M. Cracpote était furieux. Il cherchait des yeux notre nouvelle maîtresse. Lorsqu’il l’a aperçue, les cheveux en bataille et l’ourlet de sa robe pendouillant bizarrement, ses yeux se sont agrandis. » (p. 29)
« L’avenir de Mlle Charlotte dépendait de moi. Je disposais de quelques minutes seulement pour séduire tous les parents. Et, surtout, pour les convaincre de ne pas renvoyer notre nouvelle maîtresse. » (p. 87)
- Intrigue riche en rebondissements, où les actions excentriques et cocasses de l’enseignante font valoir l’importance de placer l’élève au cœur de son apprentissage; thèmes exploités (p. ex., pédagogie hors de l’ordinaire, humour, amitié) aptes à intéresser le lectorat visé.
- Plusieurs illustrations de style caricatural contribuant à la vraisemblance des personnages et des événements et permettant au lectorat d’établir des liens avec le texte.
- Texte généralement pleine page, divisé en huit chapitres bien identifiés, suivis d’un épilogue; éléments graphiques (p. ex., guillemets, tirets, points de suspension, italiques, majuscules) facilitant l’interprétation de l’œuvre; aperçu de l’intrigue et notes complémentaires sur la quatrième de couverture.
Langue
- Registre de langue courant dans l’ensemble de l’œuvre; emploi de mots familiers et de quelques mots nouveaux que le contexte permet de découvrir (p. ex., diplodocus, empiffrer, cramoisie).
- Variété de types et de formes de phrases qui contribuent à la lisibilité de l’œuvre et qui ajoutent du dynamisme et de l’agrément à la lecture.
« Les minutes coulaient au ralenti, dans le silence. Mlle Charlotte semblait réfléchir intensément. Soudain, elle a demandé :
– De telles batailles se produisent-elles souvent?
« Souvent »… Ça veut dire quoi, « souvent »? Tous les jours? toutes les semaines? toutes les récrés? Au pif, j’aurais dit deux ou trois fois par semaine. Pas plus, je crois. […]
– Disons que je me suis un peu emporté. D’habitude, on se fait pas si mal…
Le pauvre ne savait plus quoi dire. Sans doute aurait-il dû se taire. » (p. 50)
« Parfois, le soir, lorsque je parle à Gertrude, j’ai l’impression que Mlle Charlotte m’entend. Je me dis alors que mon intuition du début était peut-être bonne : et si Mlle Charlotte venait réellement d’une autre planète? Elle vogue peut-être dans l’espace en ce moment, à quelque mille milliards d’années-lumière de nous. Mails elle voit tout, elle entend tout, grâce à son caillou. » (p. 106)
- Nombreuses figures de style (p. ex., onomatopées, comparaisons, métaphores) ainsi que nombreuses expressions figurées qui évoquent des images dans l’esprit du lectorat et enrichissent le texte.
« D’habitude, les maîtresses marchent très vite. Elles sont toujours pressées. Leurs talons font klonk! klonk! klonk! klonk! klonk! dans le corridor. Ce matin-là, c’était différent. Notre nouvelle maîtresse semblait prendre tout son temps. On entendait deux ou trois petits clop, clop. Puis, plus
rien. » (p. 11)
« Elle se nommait Mlle Charlotte et venait d’un lointain village dans le nord du Québec. C’est du moins ce qu’elle disait. Mario jurait que c’était de la bouillie pour les chats. À son avis, la nouvelle maîtresse était une espionne. Les mots doux à son caillou servaient de codes secrets. » (p. 25)
- Prédominance de séquences descriptives, entrecoupées de séquences dialoguées apportant des précisions sur les lieux, les personnages et les événements et permettant de s’immiscer dans l’esprit des personnages.
« À 5-4, la lutte était serrée; les cris fusaient de tous bords, tous côtés. J’étais en nage, les autres aussi. Le chignon de Mlle Charlotte était démoli et sa robe, drôlement salie. Nous étions tous trop occupés pour remarquer M. Cracpote. Mélanie Gravel a failli s’étouffer en fonçant droit dans son gros ventre mou. J’ai entendu un cri. Tout le monde s’est arrêté. » (p. 28)
« Elle nous a d’abord raconté une histoire d’horreur. Pendant quelques minutes, la salle de classe a disparu. Nous étions transportés dans un cimetière obscur peuplé de morts vivants. C’était une nuit d’orage, glaciale. » (p. 33)
« M. Cracpote a raconté ce qu’il avait déjà dit la veille, dans la classe de Mlle Lamerlotte. Plusieurs parents ont exprimé hautement leur indignation.
– Mais c’est inacceptable!
– Cette femme est peut-être dangereuse!
– Il faut agir vite…
– Et pas seulement la mettre à la porte… la poursuivre en justice! » (p. 86)
Référent(s) culturel(s)
- Présence de référents langagiers relevant de la vie quotidienne du Canada français (p. ex., capotée, belle crotte d’amour, tourtière, poutine).
Pistes d'exploitation
- Proposer aux élèves, regroupés en équipes, de discuter du caractère de Mlle Charlotte, puis de répondre à la question suivante : Aimerais-tu avoir une enseignante comme elle? Demander à chaque élève de résumer son opinion dans son carnet de lecture tout en justifiant son point de vue. Animer une mise en commun afin de permettre aux élèves de faire part de leur réflexion au groupe-classe.
- Les élèves de la classe de Mlle Charlotte ont raffolé de la méthode d’apprentissage par projet (p. ex., mesurer le périmètre de la classe en se servant de nouilles cuites). Demander aux élèves d’identifier un projet qu’ils aimeraient réaliser, en lien avec une matière à l’étude (p. ex., alimentation saine, roches et minéraux, électricité). Planifier en groupe-classe l’élaboration du projet choisi.
- Proposer aux élèves, réunis en dyades, de préparer une entrevue avec un personnage du roman (p. ex., Mlle Charlotte, le directeur, Mathieu Bérubé) en suivant les étapes suivantes :
- Formuler des questions ouvertes.
- Discuter d’une réponse appropriée à chaque question.
- Assigner le rôle d’intervieweuse ou d’intervieweur à un des membres de l’équipe et celui du personnage choisi à l’autre.
Inviter les équipes à présenter leur entrevue devant le groupe-classe.
Conseils d'utilisation
- L’auteure décrit une bagarre qui a lieu entre Mathieu et Vu (p. 47). Relire le passage avec les élèves puis animer une discussion sur l’intimidation et le respect des autres. En profiter pour apporter des solutions encourageant la tolérance et l’accueil.
- Consulter les fiches pédagogiques qui accompagnent le roman sur le site de la maison d’édition Québec Amérique ainsi que sur le site de la maison d’édition Gallimard Jeunesse.
- Inviter les élèves à lire les autres œuvres de la série Charlotte, telles que La Mystérieuse Bibliothécaire, Une gouvernante étonnante, La fabuleuse entraîneuse et Une infirmière du tonnerre, dont les fiches pédagogiques se trouvent dans FousDeLire.
- Offrir aux élèves le choix de faire la lecture du roman en écoutant le disque compact, qui comprend la narration du texte par l’auteure, agrémentée d’un accompagnement musical et sonore.
Ressource(s) additionnelle(s)
- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 1re à 8e année, Série : Le bus magique, divers épisodes.