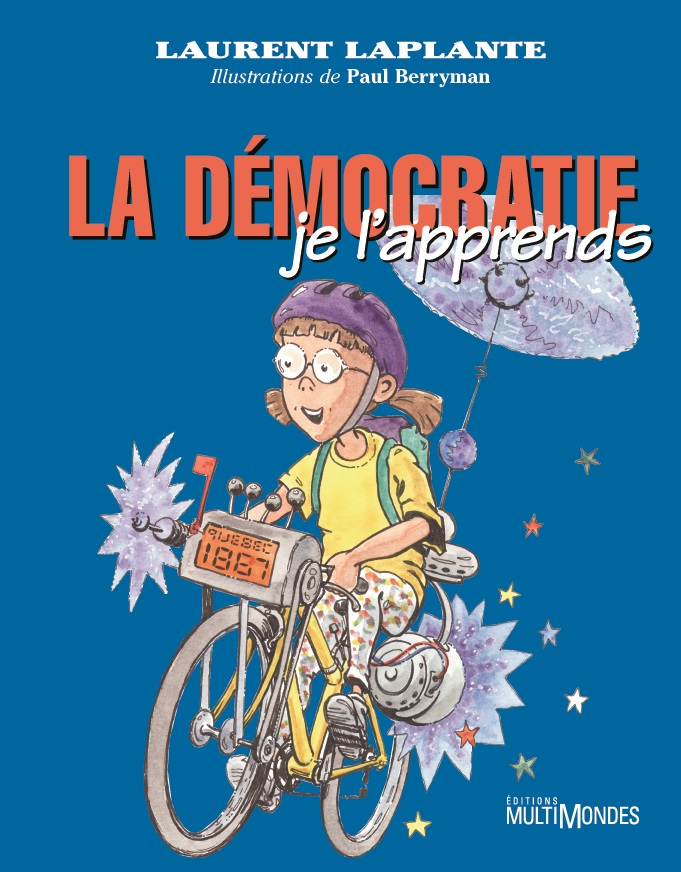Contenu
- Troisième ouvrage d’une série de quatre, qui renseigne le lectorat sur l’histoire de la démocratie au Québec et au Canada, depuis 1867 jusqu’à présent; œuvre informative, témoignant des embûches encourues au fils des ans, ainsi que des progrès réalisés, permettant au lectorat d’apprécier l’héritage d’un système qui continue toujours à se démocratiser.
« Les votes ne sont pas toujours aussi beaux que le tien. Je vais t’en raconter qui n’ont été ni libres ni beaux. Mes histoires d’élections, elles sont vraies, mais pas toujours jolies. (Si tu veux savoir d’où viennent mes histoires, tu peux aller à la dernière page : tu verras dans quels livres je les ai trouvées.) » (p. 1)
« À l’époque des grands-parents de nos grands-parents, il y avait des évêques et des prêtres qui essayaient de « guider le vote ». Bien sûr, les prêtres aussi ont droit à leur opinion, mais certains voulaient alors imposer leur opinion aux électeurs. » (p. 7)
« Tu as bien lu. C’est en 1936 seulement, 48 ans après l’Ontario, 16 ans après Ottawa, que Québec dit clairement que tous les citoyens peuvent voter. Il fallait de la patience.
Pour les femmes, il faudra trois ans de plus. Et, même alors, le changement a eu besoin d’un premier ministre astucieux. » (p. 13)
- Texte à caractère pédagogique et dynamique; emploi de procédures qui poussent le lectorat à réfléchir et à garder l’œil vigilant, afin de continuer à nourrir et à améliorer la démocratie canadienne; emploi de la vulgarisation, permettant au lectorat de comprendre des notions plutôt abstraites et complexes; sujet apte à intéresser le lectorat visé de par les thèmes exploités, (p. ex., faits historiques, vote public et secret, influence du clergé, pouvoir de l’argent, influence des médias, préjugés raciaux et religieux, transparence, justice), lui permettant de faire des liens avec son vécu.
« Dans beaucoup de pays, les partis choisissent une couleur, un drapeau, un animal symbolique. Cela facilite la publicité! Aux États-Unis, deux animaux symbolisent les partis républicain et démocrate : l’éléphant et l’âne. En Angleterre, on surnommait les conservateurs et les libéraux « tories » et « whigs ». Ici, un conservateur est un « bleu », un libéral un « rouge ». Tu verras tantôt ce qu’on peut faire dire à ces couleurs… » (p. 4)
- Intégration de textes de genres variés (p. ex., lettres, articles de journaux, extrait de roman), appuyant le contenu et contribuant à la compréhension de la thématique.
- Nombreuses illustrations de style caricatural, qui contribuent à la compréhension du texte et qui véhiculent des points de vue explicites et implicites, faisant appel à l’esprit critique du lectorat.
- Mise en page chargée; texte découpé de façons variées (p. ex., paragraphes titrés et sous-titrés, encadrés, listes en style télégraphique), contribuant à la lisibilité de l’œuvre et favorisant l’étude morcelée de l’ouvrage; éléments graphiques (p. ex., grosseur et couleur de polices, italiques, caractères gras, guillemets, puces variées, points de suspension, listes) facilitant l’interprétation du texte; bibliographie citant la source des « histoires » racontées par l’auteur à la fin de l’œuvre.
Langue
- Registre de langue courant dans l’ensemble de l’œuvre, populaire à l’occasion; champs lexical relié au thème de la démocratie (p. ex., listes électorales, préjugés raciaux ou religieux, financement des partis, caisse électorale), les termes étant souvent définis à partir du contexte ou à l’aide des illustrations.
- Utilisations de phrases de base, de phrases transformées, de types et de formes variés, et de phrases à construction particulière, permettant une lecture dynamique de l’œuvre; utilisation prédominante du « tu », servant à interpeller directement le lectorat visé.
« Le témoin Étienne-Théodore Paquet, député de Lévis à la Législature, s’était trouvé à la Baie-Saint-Paul le dimanche précédant le vote. Il avait entendu le curé Sirois, en chaire, mettre les fidèles en garde contre un parti anticlérical qui voulait abolir la dîme et affamer les prêtres. Emporté par son imagination luxuriante, le curé avait prédit, à la suite du libéralisme, une révolution prochaine où les prêtres seraient persécutés. » (p. 8)
« Donc, vers 1867, pas de droit de vote aux pauvres ni aux jeunes. Pas de droit de vote non plus pour les femmes. » (p. 10)
« Les électeurs ont changé. Les candidats ont changé. Le système a-t-il changé? Oui et non. Parfois, il a changé. Parfois, il n’a pas bougé. Parfois il a bougé, mais dans la mauvaise direction. » (p. 32)
- Emploi de procédés stylistiques variés (p. ex., interjection, énumération, répétition, expressions familières et figurées) qui ajoutent de l’humour au texte, permettant au lectorat d’apprécier le style de l’auteur.
« Ouf! Des troupes, la police, la cavalerie! Les gens étaient-ils plus violents? Je ne sais pas, mais le vote était public. » (p. 6)
« Cette attitude va durer, durer, durer. Pendant quarante ans, à peu près personne n’osera demander que les femmes puissent voter. » (p. 10)
« La transaction, dit Joly, cache anguille sous roche. L’anguille a même le format d’un boa! Les docteurs Landry et Roy se disent propriétaires de l’Asile, mais le docteur Roy sert de prête-nom ou de masque à Joseph Cauchon. La preuve, c’est que l’Asile de Beauport reçoit 150 000$ par année, tandis que le bon docteur Roy reçoit un salaire de 2 000$! » (p. 31)
- Prédominance de séquences descriptives qui situent le lectorat dans le temps et le lieu de l’action, tout en le renseignant sur le sujet de la démocratie; peu de séquences dialoguées.
« Si l’autre parti avait les meilleurs boxeurs, il fallait du courage pour dire publiquement : « Moi, je vote pour l’autre candidat! » Voter en public comme les grands-parents de nos grands-parents, c’était risquer son emploi ou… son nez! » (p. 3)
« As-tu remarqué ces mots : « Il s’attache des hommes politiques… »? Le système permettait cela. Des hommes honnêtes ont combattu ce système, mais ils ont souvent frappé un mur. Ces hommes voulaient empêcher les administrateurs de compagnies ferroviaires d’être députés et surtout ministres. Il y eut même un projet de loi présenté par Pierre Bachand, député libéral de Saint-Hyacinthe, « pour déclarer inéligible et incapable de siéger dans l’Assemblée législative (…) tout actionnaire de compagnie… » ». (p. 26)
« Un exemple de ce que pouvait donner cette parenté entre la politique et le journalisme, c’est celui de Joseph Cauchon, un monsieur que tu connais maintenant. Joseph Cauchon est un homme important au Québec en 1867. Propriétaire du Journal de Québec, maire de la capitale, il est député et a failli être le premier premier ministre du Québec. » (p. 30)
Référent(s) culturel(s)
- Mention de nombreux politiciens québécois (p. ex., George-Étienne Cartier, Louis-Alexandre Taschereau, Wilfrid Laurier, René Levesque, Gédéon Ouimet).
- Mention de la ville d’Ottawa, en Ontario.
- Mention de lieux situés au Québec (p. ex., Chicoutimi, l’Anse Saint-Jean, Kamouraska, Montréal, Sorel, Baie-Saint-Paul, Trois-Rivières).
- Mention d’institutions bancaires (p. ex., La Banque de Montréal, La Banque de Saint-Hyacinthe).
Pistes d'exploitation
- Animer une table ronde à partir de l’énoncé suivant : Tu verras comment nos grands-parents et les grands-parents de nos grands-parents ont fait pour que tu puisses voter aujourd’hui sans risquer ta peau à chaque fois. Il leur a fallu du courage, de l’honnêteté, des rayons X et même plus. (p. 1) Demander aux élèves d’expliquer l’énoncé, en donnant des exemples tirés du texte pour justifier leur réponse.
- Demander aux élèves, réunis en dyades, de comparer le système démocratique parlementaire tel qu’il existait au tournant du XXe siècle, et celui qui existe aujourd’hui (p. ex., le vote public / le vote secret), puis de noter les ressemblances et les différences à l’aide d’un tableau comparatif. Animer une mise en commun afin de leur permettre de présenter leur travail au groupe-classe.
- Animer une discussion sur la question suivante : Pourquoi les intérêts de certains groupes sont-ils protégés dans le pacte fédératif de 1867, tandis que ceux d’autres groupes ne le sont pas (p. ex., les intérêts des catholiques sont protégés, mais pas ceux des peuples autochtones et des femmes).
- Proposer aux élèves, regroupés en équipes, d’utiliser un schéma pour démontrer le fonctionnement du système gouvernemental canadien, selon la Loi constitutionnelle de 1867 (p. ex., Couronne, Sénat, Chambre des communes, pouvoirs). Afficher les travaux au centre de ressources de l’école.
Conseils d'utilisation
- Offrir aux élèves un accompagnement étroit durant l’étude de la thématique, afin de faciliter la compréhension des divers concepts, qui peuvent s’avérer complexes et abstraits.
- Ajouter des référents ontariens durant l’étude de la thématique afin de créer des liens avec le vécu des élèves franco-ontariens.
- Présenter ou revoir les règles de la table ronde.
- Encourager les élèves à lire les trois autres œuvres de la série, soit La démocratie j’aime ça!, La démocratie je la reconnais et La démocratie je l’invente!, dont les fiches pédagogiques se trouvent dans FousDeLire.
Ressource(s) additionnelle(s)
- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 4e à 6e année, Série : Justice, Moutarde et Cornichons, La démocratie.
- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 5e à 10e année, Série : Active-toi, Les droits de la personne.
- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 4e à 6e année, Série : Appartement 611, La charte canadienne.
- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 1re à 6e année, Série : 1 Jour, 1 Question, C’est quoi la démocratie?
- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 7e à 12e année, Série : Anatomie des fausses nouvelles, Le rôle de l’information en démocratie.