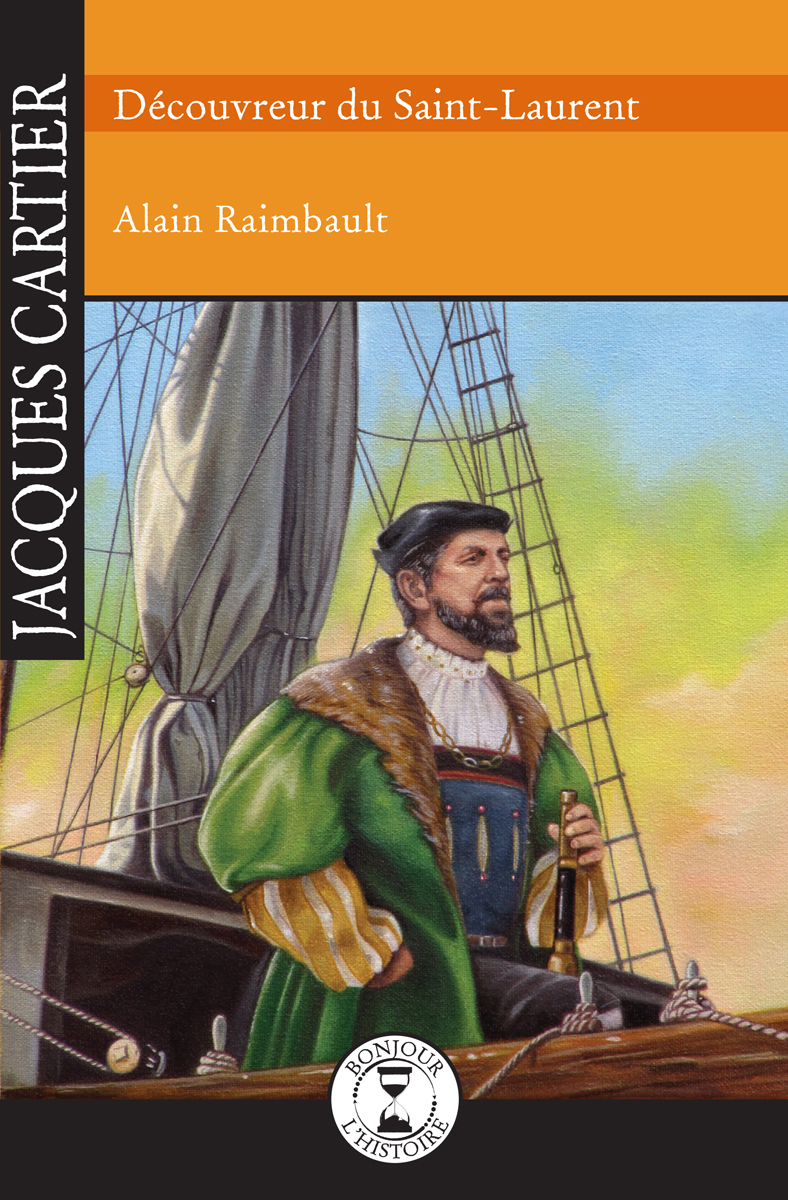Contenu
- Un personnage principal, Jacques Cartier, explorateur important grâce à ses connaissances et à ses qualités de marin, marié avec Catherine des Granges, fille du gouverneur civil de Saint-Malo; quelques personnages secondaires, dont le roi de France, François 1er, les membres d’équipage, Donnacona et ses fils, Domagaya et Tignoagny, et les Autochtones.
« Le futur explorateur reçoit une éducation religieuse à Saint-Malo. C’est un élève très studieux.
Il sait que pour devenir pilote de navire, il doit entreprendre une solide formation et naviguer le plus souvent possible. Au port, il apprend à construire des navires. Seul ou avec l’aide de ses précepteurs*, il découvre l’astronomie* et toutes les sciences utiles à la navigation. Il étudie également la cartographie*. » (p. 8)
« Catherine des Granges est une amie d’enfance. Elle est la fille du gouverneur civil de Saint-Malo, un homme riche et influent. Comme les parents de Jacques ne sont que des petits commerçants, son mariage avec Catherine constitue une promotion sociale considérable. Les noces sont célébrées en avril 1520. Jacques devient un homme très important, d’abord par ses connaissances et ses qualités de marin reconnues par tous, ensuite grâce à ses relations avec les bourgeois de la ville. » (p. 9)
« Le 13 juin, il aperçoit des indigènes pour la première fois. Ils pêchent le loup marin dans des canots en écorce de bouleau. Ils ont les cheveux tressés, garnis de plumes. Hommes et femmes sont vêtus de peaux de bêtes. Jacques Cartier, qui ne peut les approcher de trop près car ils sont très craintifs, pense que ce sont des gens qu’il serait facile de convertir. » (p. 16-17)
- Récit décrivant la vie de Jacques Cartier et ses trois voyages dans le Nouveau-Monde; thèmes exploités (p. ex., Nouvelle-France, peuples autochtones, exploration, navigation, défis, courage) pouvant intéresser le lectorat visé.
- Mise en page aérée; texte réparti en dix chapitres titrés et numérotés; illustrations contribuant à la vraisemblance des personnages et des lieux; éléments graphiques (p. ex., guillemets, astérisques, italiques) facilitant l’interprétation de l’œuvre; dédicace au début de l’œuvre; table des matières, courte biographie de l’auteur et des illustratrices à la fin de l’œuvre; suite au texte, un Dossier Jacques Cartier comprenant un glossaire des mots identifiés par un astérisque dans le texte, un bref aperçu de quelques contemporains de Jacques Cartier, des repères chronologiques, des renseignements sur la navigation et de brefs propos au sujet des rencontres effectuées lors des expéditions.
Langue
- Registre de langue courant dans l’ensemble de l’œuvre; plusieurs mots plus complexes reliés aux thèmes exploités, certains identifiés par un astérisque et dont la définition se trouve dans le glossaire.
- Texte contenant diverses structures de phrases parfois complexes ainsi qu’une variété de types et de formes de phrases.
« À Saint-Malo, Domagaya et Tignoagny apprennent quelques rudiments de français. Ils révèlent au capitaine Cartier la présence du royaume presque légendaire du Saguenay, au bout du fleuve, où l’on trouve du fer jaune partout.
Est-ce ce [sic] pays de l’or? Le fameux Eldorado que recherchent aussi les Espagnols aux Indes? Cartier n’a pas encore abandonné ses rêves d’enfance. C’est lui qui trouvera le passage à l’ouest vers la Chine, l’Eldorado que tous cherchent. » (p. 23)
« Jacques Cartier se demande pourquoi les Autochtones survivent si bien à ce mal. Il parvient à apprendre leur secret. Il suffit de prendre de l’écorce de « l’anedda* », probablement l’épinette blanche, et d’en boire des infusions. La boisson pallie le manque de vitamine C que l’on trouve dans les légumes et les fruits frais. Les malades se rétablissent miraculeusement, mais trop tard. Au moins vingt-cinq Français meurent les jambes enflées, les dents déchaussées. Et pas moyen de les enterrer chrétiennement, car la terre gelée est dure comme le roc. » (p. 36)
- Figures de style (p. ex., métaphores, comparaisons, énumérations) qui permettent d’apprécier le style de l’auteur.
« Très vite, la traversée tourne au cauchemar. Pendant presque un mois, le vent et la tempête se déchaînent. Le ciel est si chargé qu’il fait nuit en plein jour. » (p. 25)
« Les deux Autochtones lui révèlent qu’elle est très profonde et qu’elle mène vers un royaume regorgeant de richesses. Jacques Cartier donne une description exotique du lieu où les arbres, en très grandes variétés, grands comme des mâts de navire, poussent sur des rochers. […]
L’explorateur poursuit sa découverte des îles du fleuve. D’énormes poissons, gros comme des marsouins, blancs comme neige, dont le corps et la tête ressemblent à des lévriers nagent à côté des navires. Ces poissons-chiens qui pourraient très bien illustrer une mythologie antique, ce sont des bélugas. » (p. 26-28)
« Durant l’hiver et le printemps 1541, le navigateur parvient contre tous, comme d’habitude, à armer cinq navires. Cette fois, il a pour objectif d’établir une colonie. Il embarque des maçons, des laboureurs, des charpentiers, des maréchaux-ferrants* et des aumôniers pour soigner l’âme des Français et surtout pour évangéliser les « Sauvages ». Avec les marins et les soldats, dont certains sont des prisonniers libérés, le nombre d’hommes s’élèvent à quatre-cents. » (p. 42-43)
- Séquences descriptives qui apportent des précisions sur les événements, les personnages et les lieux explorés.
« Le 24 juillet 1534, dans la baie de Gaspé, Jacques Cartier prend possession, au nom de la couronne française, des terres à peine abordées. Sur la plage, il fait ériger une croix de trente pieds de haut, soit de plus de dix mètres. Sur celle-ci, il dépose un écusson portant trois fleurs de lys et un écriteau en bois sur lequel est gravé en lettres capitales : VIVE LE ROI DE FRANCE. Ensuite, il ordonne à ses marins de s’agenouiller. » (p. 18)
« Malgré les maigres résultats de son dernier voyage, Jacques Cartier est toujours respecté à Saint-Malo. Il a encore toute la confiance du roi. Il est interprète officiel de portugais. Il est amené à servir de juré ou de témoin dans des procès et il est vingt-sept fois parrain de nouveau-nés. […]
Le premier septembre 1557, alors que sévit une épidémie de peste, Jacques Cartier meurt dans son lit. Il est inhumé dans la cathédrale de Saint-Malo, là où il a probablement été baptisé, là où il s’est marié, là où il a prié si souvent. » (p. 51-53)
- Quelques séquences dialoguées qui permettent de mieux comprendre les relations entre les personnages.
« – Monsieur, demande le roi à Jacques Cartier, pourquoi voudrions-nous aller à Cathay* quand toute la politique nous pousse vers l’Italie? Aussi, l’Anglais, notre ennemi naturel, menace sans cesse nos côtes. Pourquoi risquer les deniers* de la couronne dans une aventure aussi risquée?
Le navigateur a prévu les questions. Ses arguments sont préparés.
– Parce que, Sire, répond-il de sa voix ferme en mesurant ses mots, nos autres ennemis, les Portugais et les Espagnols sont déjà installés dans les Indes. Ils en tirent de grandes richesses qui ne servent qu’à nous affaiblir.
– C’est exact, dit le roi.
– Les richesses du nord-ouest restent à découvrir. Je connais la route vers Terre-Neuve et, à l’Occident, de grands espaces sont encore libres. J’imagine sans peine un passage direct vers l’Asie. Sa découverte imminente, Sire, nous donnerait un grand avantage sur nos concurrents. Nous en rapporterions de l’or et des épices.
– Très bien, fit le roi. » (p. 12)