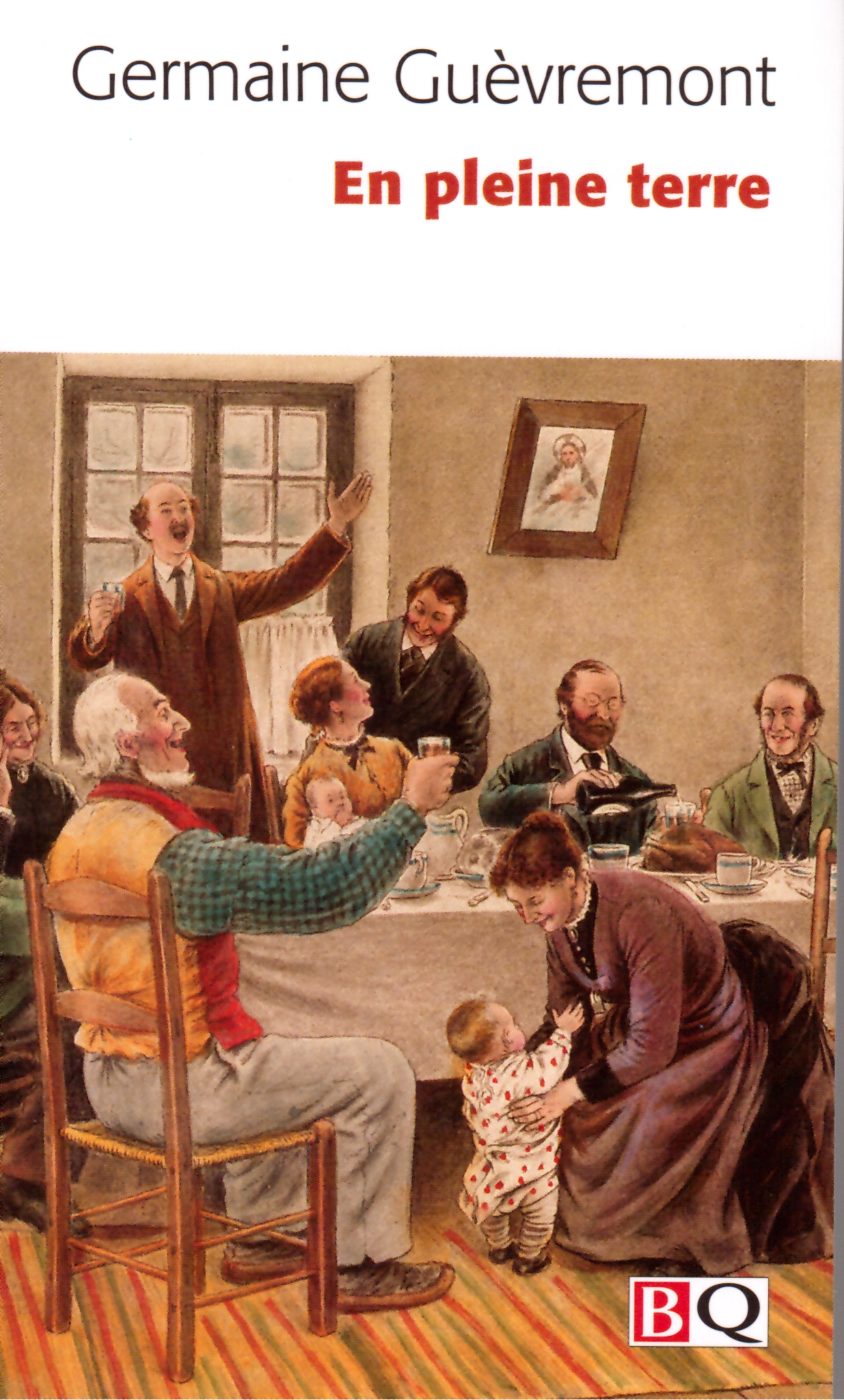- Recueil divisé en deux sections (Paysanneries, Quatre contes) regroupant des textes littéraires de structures variées (p. ex., récit, monologue, poème, conte) suivies d’un lexique regroupant des termes et des expressions d’antan.
« Une nuit féerique les attendait à la sortie de la messe. […] Sur le perron de l’église, des visages familiers accueillaient Amable et Alphonsine d’un sourire d’amitié ou d’une œillade de malice. » (p. 12-13)
« Tu m’coûtes pas cher,
t’as pas d’licence
ni d’exigences :
un peu d’avoine et t’es réparée. » (p. 47)
« Et le croiriez-vous? Deux demoiselles, ailes bleues, ailes brunes emmêlées, se disent un secret sur le bout de la canne à pêche. On le connaît si bien, le père Drapeau. Mais le plus drôle, c’est de voir la vache s’avancer jusque dans l’eau pour mieux le montrer à son veau :
– Vite, petiot! Voilà le petit bac du père Drapeau! » (p. 129)
- Personnages principaux différents selon les textes, mais pour la plupart issus du clan des Beauchemin (p. ex., Amable, Marie-Amanda, Didace); nombreux personnages secondaires tous vraisemblables et originaux appartenant surtout à la communauté de la région du Chenal du Moine.
« L’éclaircie qu’il a raclée à l’aide de ses gros ongles et qu’il a élargie à la chaleur de son souffle, dans le frimas qui engivre la vitre, permet à Amable Beauchemin d’observer les choses du dehors. Assis près de la fenêtre, il suit des yeux, sans les voir, les charrois de bois qui défilent lentement sur le chemin du roi. » (p. 9)
« Le soleil avait glissé derrière les arbres tassés en forêt quand Marie-Amanda se décida à rentrer. La tombée du soir teintait de violet la commune et fraîchissait l’air tiède de tantôt. Le tourment, oublié un instant, de songer que son amoureux retournerait naviguer la reprit avec un regain d’énergie. » (p. 21-22)
« Depuis que le malheur était entré dans la maison, la voix du maître avait perdu de son aigreur et les angles de son caractère s’étaient arrondis, pour ainsi dire, au frottement du chagrin. Comme le vin, Didace s’abonnissait en vieillissant. » (p. 59)
« LÀ-BAS DANS LES TERRES BASSES, au bout du chemin herbu qui meurt à la lisière du bois, vivait un homme tout différent des autres. Entouré des plus humbles, il ne connaissait pas l’humilité de cœur. Grand de taille, les épaules renversées, le corps raidi d’orgueil, il portait la fierté comme un roi la pourpre, et son regard altier, planant au-dessus des choses, semblait régner sur quelque empire secret. […] De son nom Godefroi, on avait fait Defroi… » (p. 67-68)
« Sèches et ossues, jaunes de teint, Ombéline et Énervale, les filles à Déi Mondor, avaient passé fleur depuis longtemps : elles approchaient de la soixantaine. À cause de la dignité de leur maintien et d’une réserve exagérée dans leurs relations avec le voisinage, on ne les nommait pas autrement que : les Demoiselles. » (p. 118)
- Textes courts, histoires le plus souvent enchâssées les unes dans les autres dont les thèmes traditionnels (p. ex., religion, us et coutumes) rappellent le Québec d’autrefois.
« À genoux devant la crèche, d’un cœur pieux, Amable contemplait ce Dieu fait enfant pour nous racheter, ses petits bras ouverts en signe de promesse, apportant mer et monde aux hommes de la terre; sa sainte Mère, la douce Vierge Marie tout de bleu vêtue, en adoration devant Lui […]. L’ancien mystère, les airs de Noël, la poésie évangélique et l’odeur de la résine agitaient au cœur d’Amable le plus pur émoi. » (p. 12)
« En hiver, sauf une veillée ici et là et la messe d’obligation, les sorties n’abondaient pas chez les paysans. Les femmes surtout demeuraient casanières. Les hommes, eux, outre les journées passées au bois, avaient fait l’équipée d’aller en bande manger la gibelotte chez un parent, dans les parages de Maska. » (p. 21)
- Narrateur omniprésent changeant au fil des histoires ou au cours de l’une d’elles.
« Un ancien racontait pour la vingtième ou pour la centième fois l’aventure de sa jeunesse. On l’écoutait patiemment, sachant qu’à chaque fois il apportait à l’histoire une variation nouvelle :
"C’t’année-là, l’eau était tellement haute que les canards sauvages venaient manger partout dans les baies." » (p. 61)
« – Quand mémère conte des contes, c’est beau.
Et Odilon, et Amable, et l’engagé, et tous l’exhortèrent si bien qu’elle commença :
– Dans l’ancien temps… » (p. 77)
« Ils riaient aux éclats, Didace le premier. Odilon se carra dans sa chaise et toussa. Il avait la réputation de pouvoir relancer le meilleur conteur d’histoires : tous se turent. » (p. 83)
- Séquences textuelles (p. ex., narrative, dialoguée, descriptive) décrivant les personnages et les situant, entre autres, dans leur milieu social ou familial.
« Prié de chanter, le chanteur de couplets s’était affaissé sur une chaise, dans l’attitude du complet découragement, comme si semblable invitation signifiait pour lui le pire des malheurs. Prostré, les yeux mi-clos, il s’était recueilli. Soudain il sortit de sa torpeur : ce ne fut d’abord qu’un frémissement des orteils, puis un mouvement plus accentué du pied droit, avant de devenir un plein accompagnement du genou et de la jambe. La voix du chanteur s’éleva… » (p. 40)
« – Vous savez que je fréquente Marie-Amanda pour le bon motif?
– Sans doute.
– Quoi c’est que vous diriez si je la mariais, vot’ fille?
– Je dirais… ah! je dirais rien en tout. » (p. 81)
« D’avoir cette fleur vivante, la chair de leur chair, accrochée à son cou, de regarder sa fière épouse accomplir pour leur joie à eux trois la besogne nécessaire, il tressaille de bonheur, d’un débordement de bonheur. Il voudrait en parler le surplus à Marie-Amanda, d’un parler franc, dans le droit fil de la vérité, mais il ne le peut pas. Toutes les choses qui rendent son sentiment fort et d’un grain serré sont liées à lui : elles adhèrent à lui comme l’écorce à l’arbre, il ne saurait les détacher pour en faire des mots. » (p. 93-94)