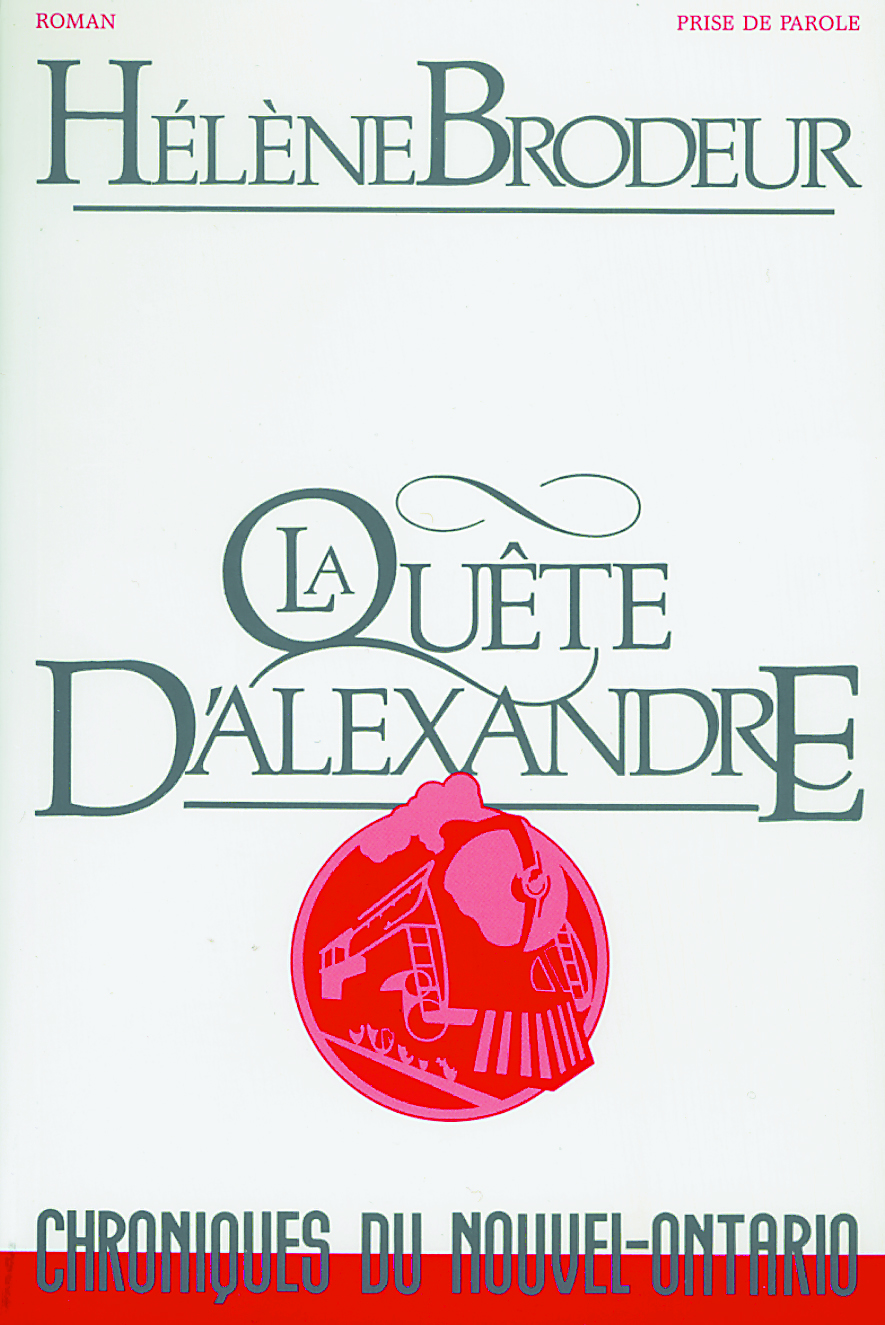2Chroniques du Nouvel-Ontario, tome 1 – La quête d’Alexandre
Au début du siècle, la construction du chemin de fer vers le Nord de l’Ontario amène la découverte d’importants gisements d’or et d’argent. Prospecteurs, aventuriers, bûcherons et fermiers affluent de partout vers cette région sauvage. De nombreux jeunes Québécois, suivant l’exemple de leurs ancêtres coureurs de bois, s’y rendent également. Parmi eux, le fils aîné du forgeron du village de Sainte-Amélie disparaîtra dans des circonstances mystérieuses. Alexandre, son frère cadet destiné au sacerdoce depuis l’enfance, partira à sa recherche. C’est ainsi qu’il fera l’apprentissage de la vie, de la liberté et de l’amour.
(Tiré de la quatrième de couverture du livre.)