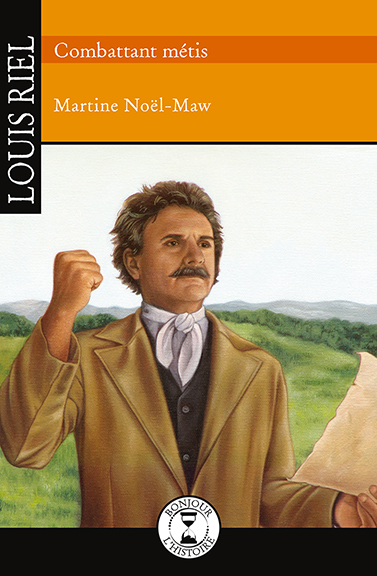Contenu
- Un personnage historique, Louis Riel, entouré de plusieurs autres personnages, dont ses parents (Jean-Louis Riel et Julie Lagimodière), son épouse (Marguerite Monet), son cousin (André Nault), le chef métis (Gabriel Dumont), le général des troupes de la Force expéditionnaire du Nord-Ouest (Frederic Middleton), un prisonnier condamné à mort pour insubordination (Thomas Scott) et plusieurs autres jouant des rôles plus ou moins importants dans la lutte des Métis et la naissance du Manitoba.
« Reconnus comme étant robustes, les Métis du Canada sont considérés comme étant les seuls au monde à avoir pu s’affirmer politiquement et à avoir revendiqué leurs droits avec un succès relatif auprès du gouvernement central. Ce succès est dû en grande partie à leur leader, Louis Riel. » (p. 8)
« Riel et Nault rassemblent une poignée d’hommes armés et partent à la rencontre des arpenteurs. Riel s’adresse en anglais à leur patron, le lieutenant-colonel John Stoughton Dennis, et lui ordonne de cesser leur travail. Devant leur refus d’obéir, Riel et ses hommes leur bloquent le passage lorsqu’ils veulent aller sur la terre de Nault. C’est le premier geste de résistance des Métis. » (p. 24)
« Il en ira autrement pour Thomas Scott, un impétueux gaillard mesurant 1,88 mètre qui se révèle être un prisonnier difficile. Déjà connu pour son caractère violent, il cause tant de problèmes dans la prison, traitant les Métis de lâches et ridiculisant la religion catholique, qu’il est traduit en cour martiale. » (p. 33)
« C’est à cette époque qu’il fait la connaissance d’une Métisse de seize ans sa cadette : Marguerite Monet, dit Bellehumeur. La jeune fille est illettrée, mais Louis tombe sous son charme. » (p. 49)
- Biographie relatant les événements importants de la vie de Louis Riel, présentés selon l’ordre chronologique; thèmes exploités (p. ex., bataille, Métis, droit, colonisation, Confédération, gouvernement, Manitoba) pouvant intéresser le lectorat visé.
- Texte aéré, généralement pleine page, divisé en dix chapitres titrés; éléments graphiques (p. ex., guillemets, astérisques, points de suspension, italiques, tirets, parenthèses) facilitant l’interprétation du texte; glossaire, liste des contemporains de Louis Riel, repères chronologiques et renseignements additionnels dans le « Dossier Louis Riel » à la suite de l’épilogue; courtes biographies de l’auteur et des illustratrices, table des matières et liste des titres parus dans la collection Bonjour l’histoire à la fin de l’œuvre.
Langue
- Registre de langue courant dans l’ensemble de l’œuvre; termes propres à la culture métisse ainsi qu’à la réalité administrative, sociale, militaire et politique de l’époque, identifiés par un astérisque et définis dans le glossaire (p. ex., troquerait, pemmican, colonie, spéculateur, résistance, Confédération).
- Types et formes de phrase variés permettant une lecture fluide et traduisant des états affectifs.
« – Bien chère maman. Soyez forte comme vous savez l’être. Je suis entre bonnes mains.
– Va, mon garçon. Ils t’attendent. Fais honneur aux Riel, aux Lagimodière et aux Métis. » (p. 11)
« À la mi-février, la tension monte. Les Métis apprennent que d’ex-prisonniers, dont Thomas Scott, veulent attaquer le Fort Garry pour libérer les sympathisants canadiens qui y sont encore emprisonnés. Les hommes sont de nouveau arrêtés. Le leader présumé du groupe, le major Charles Boulton, est traduit en cour martiale et condamné à mort pour insubordination, mais Riel intervient et la sentence ne sera pas appliquée. » (p. 33)
« – Monsieur le curé! rétorque Riel. Vous êtes tellement respectueux de cette autorité qu’elle vous aveugle. Ne voyez-vous pas dans quelles conditions pitoyables vivent vos paroissiens? Nous ne pouvons endurer plus longtemps ces injustices. Il est temps de montrer les dents! » (p. 56)
- Quelques figures de style (p. ex., antithèse, métaphore, énumération, comparaison) qui enrichissent le texte.
« Il y avait aussi une grande différence de vision entre les Blancs et les Premières Nations : pour les Blancs, la terre leur appartient, tandis que pour les Premières Nations, elles appartiennent à la terre. » (p. 8)
« Les grands yeux presque noirs de Louis se couvrent d’un voile humide lorsqu’il pose son regarde sur sa mère. » (p. 11)
- Séquences narratives et descriptives permettant de se représenter les événements, les lieux ainsi que les sentiments des personnages et rappelant la persévérance de Riel et des Métis.
« Le deuxième coup d’éclat du Comité national des Métis survient le 2 novembre. Ce jour-là, Riel et cent vingt hommes prennent possession du comptoir de la Compagnie de la Baie d’Hudson du Fort Garry. Comme il s’agit d’un point stratégique avec ses hauts murs et ses canons, ils veulent éviter qu’il ne soit pris par les sympathisants canadiens. » (p. 27)
« La tension commence à peser lourd sur le moral de Riel qui se détourne de la politique pour embrasser son ancienne vocation : la religion. Il devient de plus en plus obsédé par l’idée qu’il est investi de la mission de veiller à la destinée spirituelle des Métis. » (p. 45)
« En juillet 1885, s’ouvre à Regina, la capitale des Territoires du Nord-Ouest, le procès le plus célèbre de l’histoire du Canada : celui de Louis Riel. » (p. 62)
- Séquences dialoguées contribuant au récit des événements et révélant certains traits de caractère des personnages ainsi que les liens qui unissent ces derniers.
« – Qu’est-ce qui t’arrive, André? On dirait que tu as le feu au derrière.
– Louis, tu dois venir avec moi. Tout de suite! dit Nault, à bout de souffle. On a besoin de toi.
– Qu’est-ce qui se passe?
– Les arpenteurs du gouvernement! Ils sont arrivés! Ils sont sur la terre de Marion.
– Les arpenteurs? C’est donc vrai que Macdonald va subdiviser nos terres sans nous demander notre avis et les donner à des colons canadiens.
– Viens vite! dit Nault. Il faut les arrêter.
– Pourquoi moi?
– Parce qu’ils parlent tous anglais! On leur dit d’arrêter, de s’en aller, mais ils ne comprennent pas. Ou font semblant de ne pas comprendre.
– Je te suis! dit Louis en enfonçant sa hache dans un billot de bois. » (p. 23)
« – Nous devons former notre propre gouvernement. Nous devons lutter pour nos droits. Personne ne le fera à notre place.
– On n’a pas l’autorité pour créer un gouvernement, dit un modéré.
– Faux! objecte Riel. Selon le droit international, s’il n’y a pas de gouvernement régnant, ce qui est le cas ici puisque nous avons réussi à repousser McDougall, les habitants peuvent en constituer un. Nous pouvons créer notre propre gouvernement. Un gouvernement démocratique et bilingue! » (p. 28)
Référent(s) culturel(s)
- Référence à la Loi sur le Manitoba, qui reconnaît l’égalité du français et de l’anglais, aux Métis, aux Premières Nations.
- Référence aux faits historiques de l’époque de la Rébellion de la rivière Rouge, de la création du Manitoba et de la Rébellion du Nord-Ouest.
Pistes d'exploitation
- Demander aux élèves, regroupés en dyades, d’effectuer une recherche sur les activités organisées au Manitoba pour célébrer la journée Louis Riel, le troisième lundi de février. Leur demander de faire part au groupe-classe de leurs trouvailles, accompagnées de photos, sous la forme de leur choix (p. ex., collage, diaporama).
- Demander aux élèves, regroupés en dyades, de préparer un collage de photos représentant des éléments culturels et des traditions propres aux Métis. Animer une mise en commun afin de leur permettre d’expliquer leurs images au groupe-classe.
- Demander aux élèves, réunis en équipes, de brosser le portrait psychologique de Louis Riel en tenant compte de critères précis (p. ex., qualités, défauts, actions, points de vue) et en les appuyant d’exemples tirés du roman. Regrouper les équipes, puis les inviter à faire part de leurs trouvailles aux membres de leur groupe.
- Demander aux élèves, regroupés en dyades, de créer une ligne chronologique en y plaçant les événements importants de la vie de Louis Riel. Animer une mise en commun afin de leur permettre de faire part de leur travail au groupe-classe.
Conseils d'utilisation
- Avant la lecture, présenter aux élèves la carte géographique (p. 6) et les encourager à s’y référer tout au long de la lecture du récit.
- Accorder une attention particulière au sujet délicat dont on traite dans l’œuvre, soit la pendaison du héros.
- Consulter la fiche d’activités pédagogiques disponible sur le site de l’éditeur.
- Inviter les élèves à lire d’autres œuvres de la même collection, telles que Michel Sarrazin – Médecin et botaniste en Nouvelle-France et Jacques Cartier – Découvreur du Saint-Laurent, dont les fiches pédagogiques se trouvent dans FousDeLire.
Ressource(s) additionnelle(s)
- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 3e à 8e année, Série : La quête, Kelsie – Louis Riel.
- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 5e à 12e année, Série : Vous l’savez astheure, Journée Louis Riel.