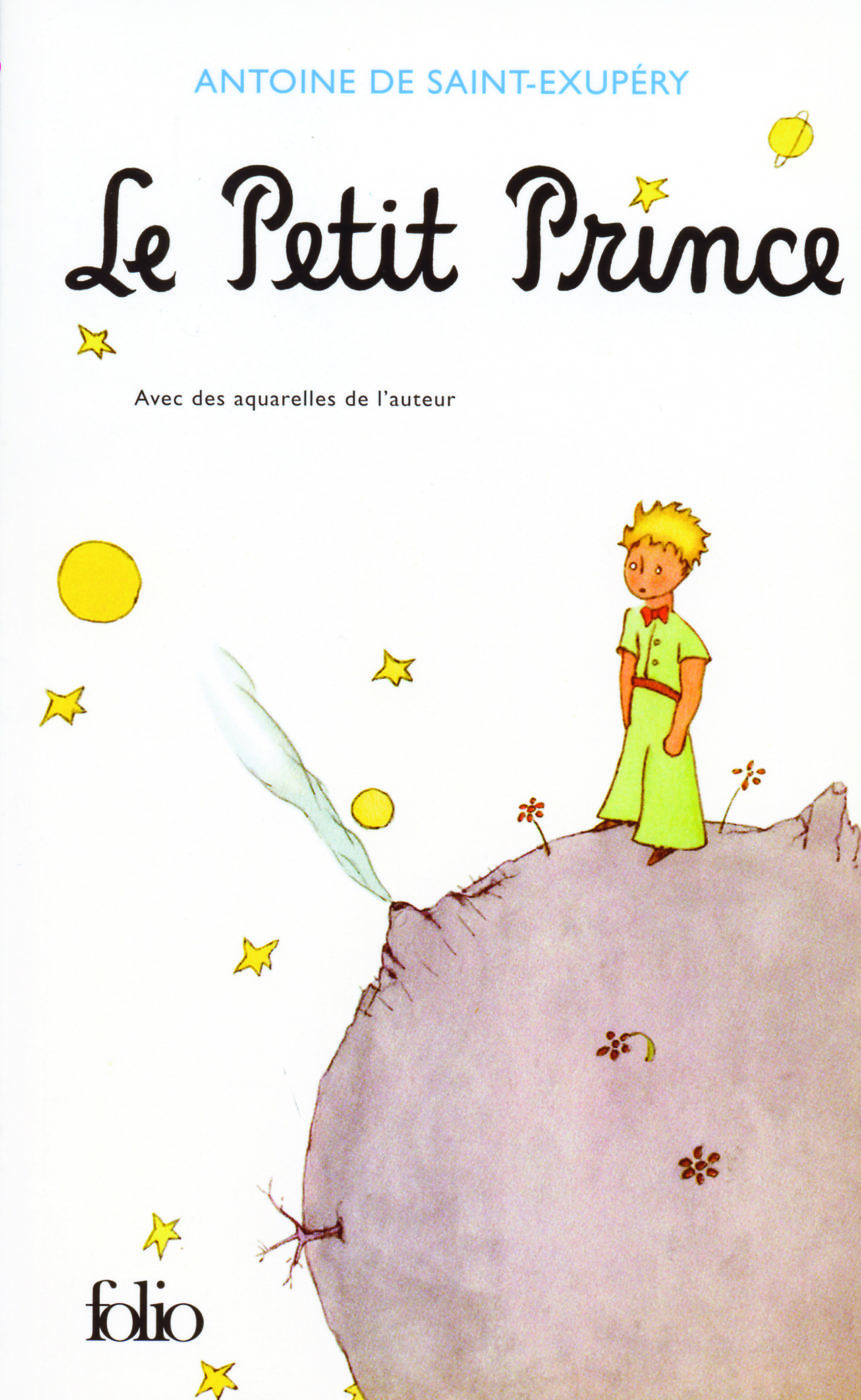Contenu
- Roman mettant en scène deux personnages principaux, le narrateur, un aviateur dont l’appareil tombe en panne dans le désert du Sahara, et le petit prince, un enfant venu d’une autre planète et avec qui l’aviateur se lie d’amitié.
« Quelque chose s’était cassé dans mon moteur. Et comme je n’avais avec moi ni mécanicien, ni passagers, je me préparai à essayer de réussir, tout seul, une réparation difficile. C’était pour moi une question de vie ou de mort. J’avais à peine de l’eau à boire pour huit jours.
Le premier soir je me suis donc endormi sur le sol à mille milles de toute terre habitée. J’étais bien plus isolé qu’un naufragé sur un radeau au milieu de l’océan. Alors vous imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une drôle de petite voix m’a réveillé. Elle disait :
– S’il vous plaît… dessine-moi un mouton!
– Hein!
– Dessine-moi un mouton… » (p. 12)
« Le petit prince, qui me posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les miennes. Ce sont des mots prononcés par hasard qui, peu à peu, m’ont tout révélé. Ainsi, quand il aperçut pour la première fois mon avion […] il me demanda :
– Qu’est-ce que c’est que cette chose-là?
– Ce n’est pas une chose. Ça vole. C’est un avion. C’est mon avion.
Et j’étais fier de lui apprendre que je volais. Alors il s’écria :
– Comment! tu es tombé du ciel!
– Oui, fis-je modestement.
– Ah! ça c’est drôle!…
Et le petit prince eut un très joli éclat de rire qui m’irrita beaucoup. Je désire que l’on prenne mes malheurs au sérieux. Puis il ajouta :
– Alors, toi aussi tu viens du ciel! De quelle planète es-tu? » (p. 17-18)
« Le petit prince avait sur les choses sérieuses des idées très différentes des idées des grandes personnes. » (p. 61)
- Plusieurs personnages secondaires dont la fleur, le roi, le vaniteux, le buveur, le businessman, l’allumeur de réverbères, le géographe, le renard et le serpent, chacun pouvant susciter une réflexion philosophique sur la nature humaine, mais la fleur et le renard ayant des rôles plus importants; la fleur, plante coquette et vaniteuse habitant la planète du petit prince, qu’elle finit par faire fuir par ses exigences, ses ruses et ses mensonges mais qui sera la raison pour laquelle le petit prince voudra retourner sur sa planète; le renard, deuxième personnage rencontré par le petit prince sur la Terre, qui trouve sa vie monotone et souhaite être apprivoisé par le petit bonhomme.
« – Le soir vous me mettrez sous globe. Il fait très froid chez vous. C’est mal installé. Là d’où je viens…
Mais elle s’était interrompue. Elle était venue sous forme de graine. Elle n’avait rien pu connaître des autres mondes. Humiliée de s’être laissé surprendre à préparer un mensonge aussi naïf, elle avait toussé deux ou trois fois, pour mettre le petit prince dans son tort :
– Ce paravent?…
– J’allais le chercher mais vous me parliez!
Alors elle avait forcé sa toux pour lui infliger quand même des remords. » (p. 41)
« – Créer des liens?
– Bien sûr, dit le renard. Tu n’es encore pour moi qu’un petit garçon semblable à cent mille petits garçons. Et je n’ai pas besoin de toi. Et tu n’as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu’un renard semblable à cent mille renards. Mais, si tu m’apprivoises, nous aurons besoin l’un de l’autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde…
– Je commence à comprendre, dit le petit prince. Il y a une fleur… je crois qu’elle m’a apprivoisé… » (p. 86-87)
- Œuvre abordant de nombreux thèmes dont l’amitié, l’amour, la recherche du bonheur, le sens des responsabilités, le don de soi, le sens de la vie et de la mort; sujets complexes mais qui sauront plaire au lectorat visé et qui susciteront des discussions; propos de l’auteur qui critiquent les grandes personnes et soulignent l’absurdité de certains gestes ajoutant une touche d’humour et se prêtant très bien à l’exploitation de la littératie critique.
« Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules, et c’est fatigant, pour les enfants, de toujours et toujours leur donner des explications. […]
J’ai ainsi eu, au cours de ma vie, des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J’ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vues de très près. Ça n’a pas trop amélioré mon opinion. » (p. 11)
- Texte agrémenté de plusieurs aquarelles de l’auteur, certaines en couleur, d’autres en noir et blanc, facilitant la visualisation des descriptions; texte pleine page, aéré et divisé en vingt-sept courts chapitres; biographie de l’auteur à la fin de l’œuvre.
Langue
- Registre de langue courant dans l’ensemble de l’œuvre et familier à l’occasion dans les dialogues; certains mots de vocabulaire plus complexes pouvant être inférés en utilisant des stratégies de dépannage.
- Texte contenant une variété de types et de formes de phrases pouvant servir à l’enseignement des manipulations linguistiques ainsi qu’à leur effet discursif.
« Les grandes personnes aiment les chiffres. Quand vous leur parlez d’un nouvel ami, elles ne vous questionnent jamais sur l’essentiel. Elles ne vous disent jamais : « Quel est le son de sa voix? Quels sont les jeux qu’il préfère? Est-ce qu’il collectionne les papillons? » » (p. 23)
« Mais si vous leur dites : « La planète d’où il venait est l’astéroïde B 612 » alors elles seront convaincues, et elles vous laisseront tranquille avec leurs questions. » (p. 24)
« Et si je connais, moi, une fleur unique au monde, qui n’existe nulle part, sauf dans ma planète, et qu’un petit mouton peut anéantir d’un seul coup, comme ça, un matin, sans se rendre compte de ce qu’il fait, ce n’est pas important ça! » (p. 36-37)
- Œuvre riche en éléments et procédés stylistiques tels que les figures de style (p. ex., comparaisons, métaphores, personnifications, énumérations, expressions figurées), qui facilitent la création d’images mentales et permettent d’apprécier le style de l’auteur.
« Je fis remarquer au petit prince que les baobabs ne sont pas des arbustes, mais des arbres grands comme des églises… » (p. 26)
« Mais les graines sont invisibles. Elles dorment dans le secret de la terre jusqu’à ce qu’il prenne fantaisie à l’une d’elles de se réveiller. Alors elle s’étire, et pousse d’abord timidement vers le soleil une ravissante petite brindille inoffensive. » (p. 28)
« On y compte cent onze rois (en n’oubliant pas, bien sûr, les rois nègres), sept mille géographes, neuf cent mille businessmen, sept millions et demi d’ivrognes, trois cent onze millions de vaniteux, c’est-à-dire environ deux milliards de grandes personnes. » (p. 72)
« – Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple : on ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux. » (p. 92)
- Séquences descriptives qui permettent au narrateur d’exprimer son point du vue, ses opinions et ses sentiments ainsi que de décrire les événements de l’histoire.
« J’ai donc dû choisir un autre métier et j’ai appris à piloter des avions. J’ai volé un peu partout dans le monde. Et la géographie, c’est exact, m’a beaucoup servi. Je savais reconnaître, du premier coup d’œil, la Chine de l’Arizona. C’est très utile, si l’on s’est égaré pendant la nuit. » (p. 11)
« Il ne put rien dire de plus. Il éclata brusquement en sanglots. La nuit était tombée. J’avais lâché mes outils. Je me moquais bien de mon marteau, de mon boulon, de la soif et de la mort. Il y avait, sur une étoile, une planète, la mienne, la Terre, un petit prince à consoler! Je le pris dans les bras. Je le berçai. […] Je ne savais pas trop quoi dire. Je me sentais très maladroit. Je ne savais comment l’atteindre, où le rejoindre… C’est tellement mystérieux, le pays des larmes. » (p. 37)
- Séquences dialoguées qui permettent de comprendre les relations entre les personnages, de suivre le déroulement de l’intrigue et de s’immiscer dans l’esprit et l’imaginaire des personnages.
« – Adieu, dit-il à la fleur.
Mais elle ne lui répondit pas.
– Adieu, répéta-t-il.
La fleur toussa. Mais ce n’était pas à cause de son rhume.
– J’ai été sotte, lui dit-elle enfin. Je te demande pardon. Tâche d’être heureux.
Il fut surpris par l’absence de reproches. Il restait là tout déconcerté, le globe en l’air. Il ne comprenait pas cette douceur calme.
– Mais oui, je t’aime, lui dit la fleur. Tu n’en as rien su, par ma faute. Cela n’a aucune importance. Mais tu as été aussi sot que moi. Tâche d’être heureux… Laisse ce globe tranquille. Je n’en veux plus. » (p. 44)
« Ainsi, le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l’heure du départ fut proche :
– Ah! dit le renard… Je pleurerai.
– C’est ta faute, dit le petit prince, je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t’apprivoise…
– Bien sûr, dit le renard.
– Mais tu vas pleurer! dit le petit prince.
– Bien sûr, dit le renard.
– Alors tu n’y gagnes rien! » (p. 90-91)
Pistes d'exploitation
- Proposer aux élèves, regroupés en équipes, d’exprimer leurs opinions et leurs sentiments face à un des messages philosophiques ou humanitaires exploités dans l’œuvre (p. ex., le secret du renard, p. 92). Animer une mise en commun afin de permettre aux élèves de partager leurs réflexions au groupe-classe.
- Demander aux élèves, réunis en dyades, de rédiger un scénario modifiant la situation finale afin que le petit prince puisse retourner sur sa planète sans devoir mourir. Les inviter à présenter leur scénario au groupe-classe sous la forme d’une saynète.
- Proposer aux élèves d’illustrer leur personnage ou leur passage préféré en utilisant la forme de représentation de leur choix (p. ex., dessin, collage, sculpture, peinture, impression, animation), puis d’y joindre une citation. Exposer les œuvres dans la classe et inviter chacune et chacun à expliquer ses choix.
Conseils d'utilisation
- Situer le désert du Sahara sur une carte géographique. En lisant avec les élèves la biographie de l’auteur à la fin de l’œuvre, identifier sur la carte les différents lieux cités et faire les tracés des différents vols.
- Encourager les élèves à lire un autre roman qui traite de la recherche du bonheur d’autrui, soit Comme un soleil ardent, dont la fiche pédagogique se trouve dans FousDeLire.
Ressource(s) additionnelle(s)
- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 4e à 7e année, Série : Philophilo, Bonheur.