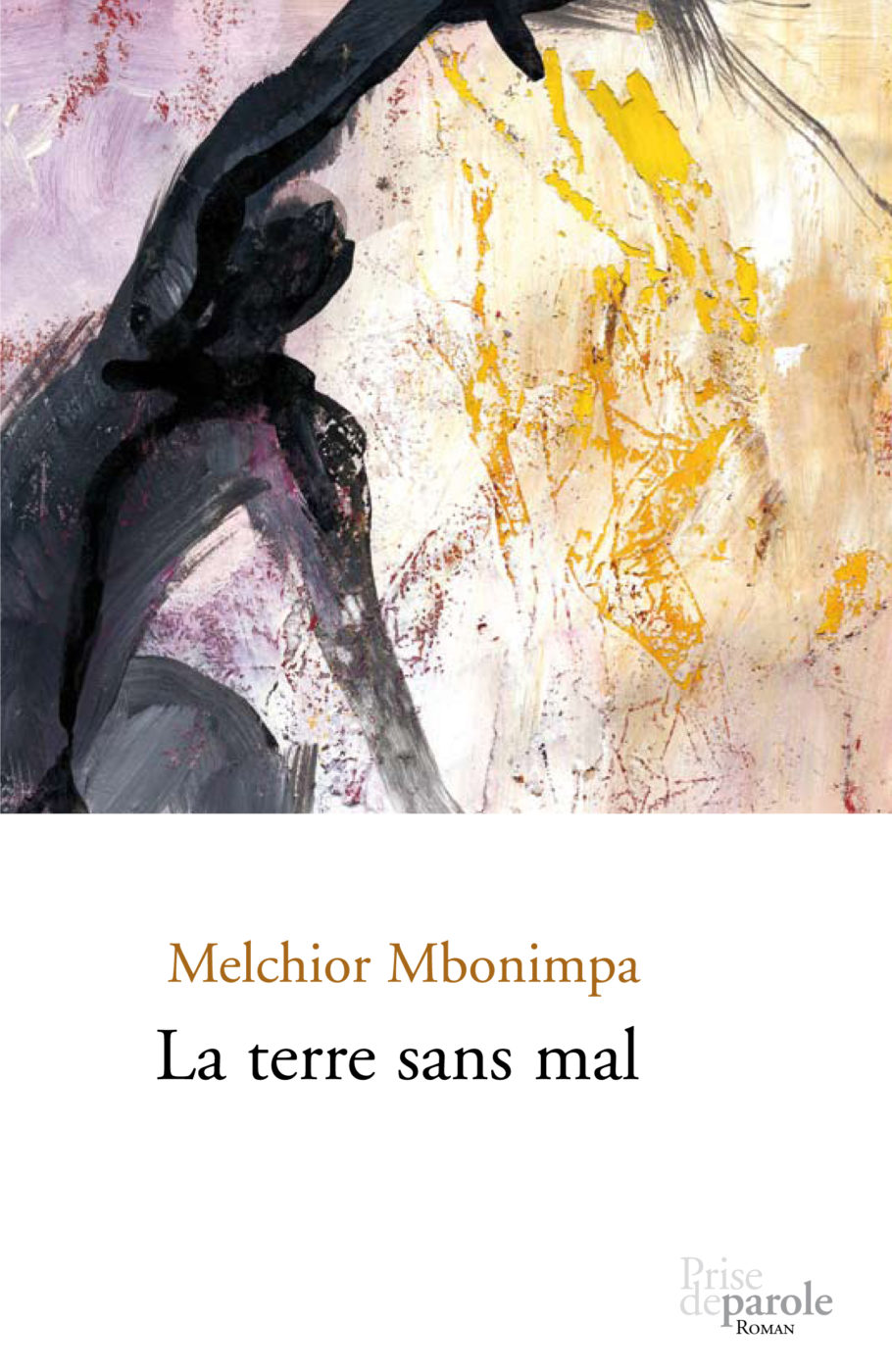La terre sans mal
Quand Teta Rébecca songe à « sa terre sans mal », le Canada, elle ne peut s’empêcher de sourire de toutes les illusions qu’elle entretenait, à son arrivée, sur son pays d’accueil. Exilée avec trois jeunes enfants à la suite de l’assassinat de son mari dans un conflit en Afrique des Grands Lacs, elle foulait pour la première fois il y a vingt ans le sol du pays de la consolation.
Or, la terre promise ne s’est pas révélée sans écueils. Aujourd’hui, à quarante-cinq ans, Teta est au bord de la folie et persuadée d’avoir raté sa vie et ses trois garçons sont à la dérive dans une société différente de leur culture d'origine. Teta se résigne donc à se confesser au père Robert dans l'espoir que ce long pèlerinage de la mémoire lui permettra de reprendre pied, de se libérer du poids des années, la déliera non seulement des atrocités vécues en Afrique mais aussi des souffrances connues au Canada.
(Tiré de la quatrième de couverture du livre.)