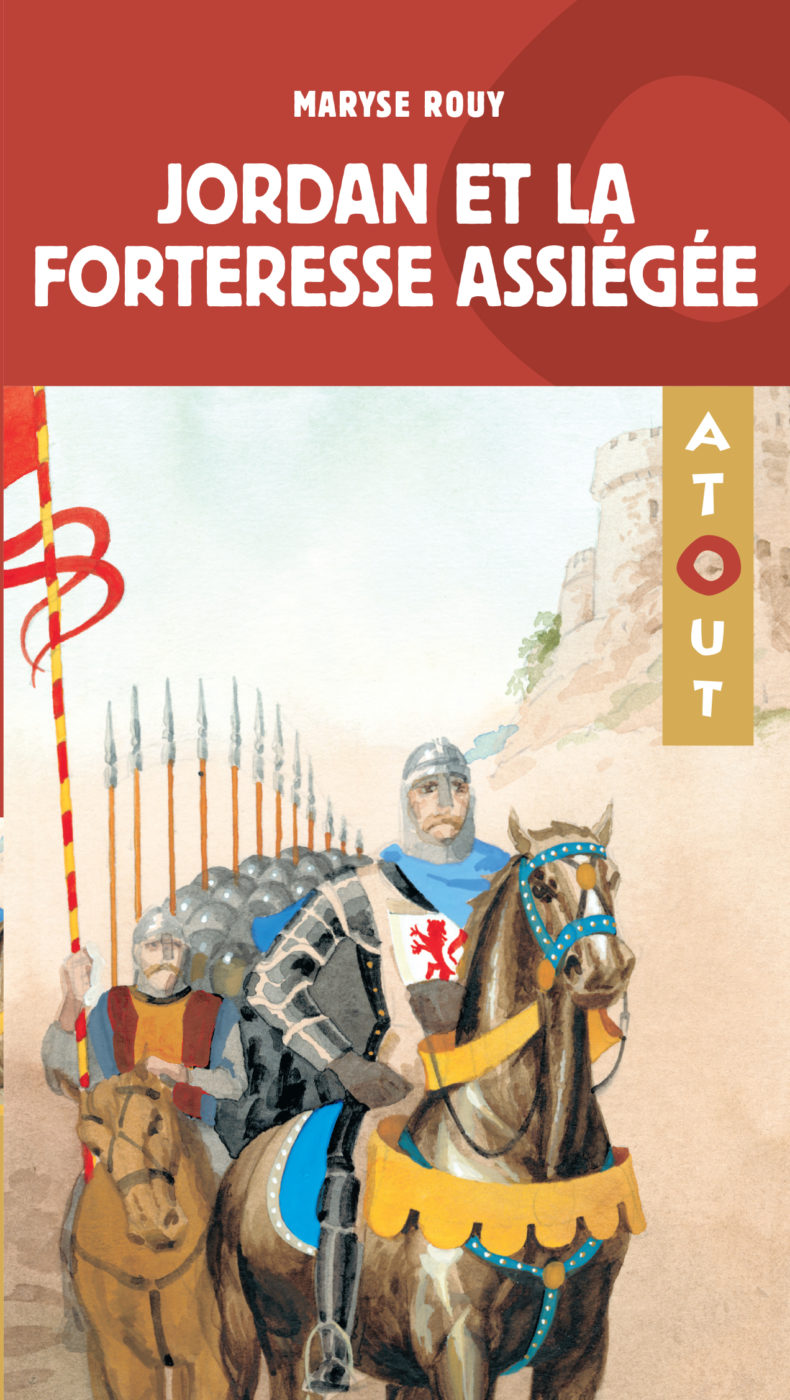Contenu
- Personnage principal, Jordan, jeune écuyer de 12 ans, qui doit quitter le château de Gourron pour devenir chevalier, se retrouvant ainsi au beau milieu d’une bataille pour reconquérir la forteresse de Mirambeau.
« Jordan se retourna avant que la boucle du chemin ne lui cache Gourron. Il s’en allait pour de longues années et voulait le regarder une dernière fois. […] Il sentit que l’émotion lui nouait la gorge, et il se détourna. Il ne voulait pas être triste. Il avait douze ans et partait à la découverte du Monde. À son retour, il serait un homme. Un chevalier. » (p. 5)
« Le comte de Montpezat ne redoutait pas la guerre. Il l’aimait, au contraire, et se réjouissait à la perspective de défaire son vainqueur de l’année précédente. Laymon avait réussi à lui prendre la forteresse de Grangeais, qui marquait la frontière entre leurs terres. » (p. 15)
« Jordan se retourna. Rémi n’était pas seul. Il était accompagné de trois jeunes gens parmi lesquels se trouvait Damien, le frère d’Isabelle. Ils l’encerclaient, menaçants. Jordan regarda Damien, dont il espéra du secours. Avant de quitter Gourron, le comte les avait présentés l’un à l’autre et il avait confié à son neveu le soin de chaperonner le novice. À son air, à la fois moqueur et arrogant, Jordan comprit qu’il ne ferait rien pour lui. » (p. 17-18)
« Après le conciliabule avec le chevalier Pradas, à qui le comte avait octroyé le château de Grangeais repris de Laymon, le seigneur de Gourron fit appeler Paulin. Il lui annonça qu’en récompense pour sa loyauté et sa bravoure, il était nommé troisième écuyer du chevalier. Afin qu’il puisse tenir son rang, Bertrand lui offrit un cheval pris à l’ennemi. Paulin croyait rêver, mais il ne rêvait pas. » (p. 101)
- Roman de chevalerie situé au Xlle siècle; intrigue bien étoffée, contenant plusieurs péripéties; thèmes exploités (p. ex., la période médiévale avec les châteaux, les chevaliers, les combats, le courage, la bravoure, l’amitié, la fidélité, l’intimidation, la trahison et la gloire) aptes à intéresser le lectorat visé.
- Texte pleine page, réparti en 11 chapitres titrés et bien identifiés; éléments graphiques (p. ex., deux-points, points de suspension, tirets, guillemets, points d’exclamation, points d’interrogation) facilitant l’interprétation de l’œuvre; court propos au sujet de l’auteure au début du livre et table des matières à la fin.
Langue
- Registre de langue courant dans l’ensemble de l’œuvre; plusieurs mots nouveaux se rapportant à l’époque médiévale (p. ex., fortifications, mâchicoulis, tourelles, muraille d’enceinte, écuyer) généralement compréhensibles grâce au contexte.
- Emploi de plusieurs types et formes de phrases qui contribuent à la lisibilité du texte; phrases contenant des manipulations linguistiques de base permettant de revoir leur utilisation.
« Dans les cuisines s’entassaient les lièvres, tourtes et perdrix que les femmes du village, réquisitionnées pour prêter main-forte, s’affairaient à dépouiller et à plumer. » (p. 7)
« Ce ne fut qu’un cri sur le chemin de ronde. Le suzerain était blessé! Il risquait d’être fait prisonnier! Que se passerait-il maintenant? Ses vassaux, voyant que leur chef était touché, allaient-ils se débander? Non. Au contraire, ils se regroupaient, repoussaient les soldats de Laymon et entouraient leur chef. » (p. 50)
- Plusieurs figures de style (p. ex., métaphores, comparaisons, énumérations) qui ajoutent à la richesse du texte.
« Depuis quelques mois, il ne parlait que de cela, et la perspective de franchir les limites de la seigneurie lui donnait des fourmis dans les jambes. En ce matin de juillet où son rêve prenait corps, il refusait de se laisser aller à la nostalgie. » (p. 6)
« Toujours au pas, ils longèrent un moment la rivière. Mais quand leurs chevaux furent échauffés, ils les lancèrent dans une course échevelée. Mettant dans la compétition la rage, la frustration et la rancune que l’attitude des grands leur inspirait, ils galopaient à fond de train dans le sentier, comme s’ils étaient seuls à l’emprunter. » (p. 27-28)
« La collation était copieuse : de belles tranches de pain bien épaisses, du fromage de brebis, des noix et des confitures, le tout produit par les moines, qui servirent aussi du vin chaud, coupé d’eau et aromatisé de miel. » (p. 38)
- Séquences descriptives qui dévoilent les émotions ressenties par les personnages et permettent de se faire une image mentale des événements et de l’époque.
« Face au pont-levis, hors de portée des flèches, des hommes assemblaient et clouaient des planches. René expliqua aux garçons qu’ils fabriquaient une sorte de mur derrière lequel ils pourraient s’abriter pour creuser un tunnel leur permettant d’accéder à la base de la forteresse. De cet endroit, inaccessible depuis les créneaux, ils entreprendraient sans risques de saper les murailles jusqu’à ce qu’elles s’effondrent, provoquant une brèche qui leur livrerait le château. » (p. 59)
« À certains, qui objectèrent qu’il n’y aurait bientôt plus rien à manger, elle répliqua :
– Il reste les chevaux.
Ils protestèrent avec véhémence. Pour un cavalier, sa monture était un bien infiniment précieux, souvent le seul qu’il possédât. Il ne considérait pas son cheval comme un animal remplaçable, mais comme un ami cher. L’idée de manger les chevaux les horrifiait, et nombreux étaient ceux qui préféraient se rendre.
Mais la comtesse les fit taire en déclarant :
– Si on doit en arriver là, on commencera par le mien.
Un silence respectueux remplaça les cris de révolte, car ils savaient la comtesse Jeanne très attachée à son cheval, qui lui avait été offert par son père avant sa mort, quelques années auparavant. Les habitants de la forteresse se dispersèrent en traînant les pieds : le découragement se généralisait. » (p. 75-76)
- Quelques séquences dialoguées qui contribuent à la compréhension de l’œuvre en permettant de se situer dans l’action et de saisir les relations entre les différents personnages.
« – Maintenant, continua-t-il, on va être coincés ici pour des jours, peut-être des semaines, à se marcher sur les pieds parce qu’il y a trop de monde. Pas de chasses, pas de cavalcades, pas de combats. On va mourir d’ennui.
– Vous n’allez pas tenter une sortie pour les disperser? demanda Rémi.
– Non. La comtesse ne prendra pas ce risque. Heureusement, il y a un homme qui a pu s’échapper : il va lever une nouvelle armée et nous secourir. En attendant, il faut défendre le château pour que ces chiens ne puissent pas s’en emparer.
– On peut lui faire confiance, à l’homme qui est parti?
– Oui. C’est le seigneur de Gourron, un chevalier fidèle et brave.
Se tournant vers Jordan, qui se rengorgeait, il ajouta :
– On compte sur ton père. » (p. 55)
Référent(s) culturel(s)
- Présence de plusieurs mots de vocabulaire provenant de l’ancien français (p. ex., les composantes d’une armure, les parties physiques d’un château, les noms de la hiérarchie militaire et celle de la noblesse).
Pistes d'exploitation
- Proposer aux élèves, réunis en dyades, de construire la maquette du château fort, à l’échelle. Exposer les œuvres au centre de ressources de l’école.
- En groupe-classe, relever les lieux mentionnés dans l’œuvre, puis demander aux élèves, regroupés en équipes, d’effectuer une recherche afin de déterminer si ces lieux sont fictifs ou réels. Jumeler les équipes, puis les inviter à comparer leur travail.
- Demander aux élèves, réunis en dyades, de trouver la recette d’un mets datant des temps médiévaux, puis de la présenter au groupe-classe.
- Poser la question suivante aux élèves : Quelles stratégies Jordan et ses amis ont-ils utilisées pour faire face aux Blaireaux et ainsi contrer l’intimidation? Par la suite, les inviter, réunis en équipes, à créer une courte saynète dans laquelle ces stratégies sont mises en pratique. Animer une mise en commun afin de leur permettre de présenter leur saynète au groupe-classe.
- Demander aux élèves, réunis en dyades, d’effectuer une recherche sur la catapulte, puis d’en confectionner une. Par la suite, amener les élèves à l’extérieur et leur demander d’en faire une démonstration, puis de noter la distance parcourue par l’objet propulsé.
Conseils d'utilisation
- Expliquer aux élèves que de nombreux mots anciens datant de l’époque médiévale se retrouvent dans l’œuvre. Leur proposer de noter ces mots puis, après la lecture, de construire un lexique en groupe-classe.
- Présenter ou revoir les caractéristiques de la recette.
- Encourager les élèves à lire les autres œuvres de la série, telles que Jordan apprenti chevalier, Les combats de Jordan et Le triomphe de Jordan, dont les fiches pédagogiques se trouvent dans FousDeLire.
Ressource(s) additionnelle(s)
- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 4e à 6e année, Série : Appartement 611, Un festin médiéval.
- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 3e à 8e année, Série : Les amis d’Axelle, Henri – L’épée médiévale.