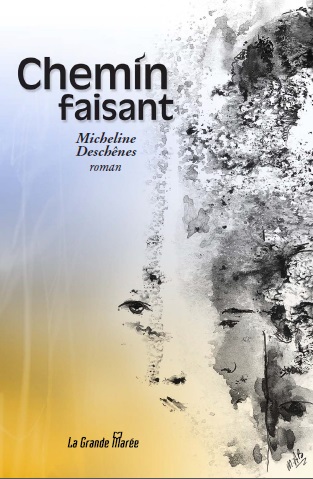- Un personnage principal, Antoine LeBlanc, ardent défenseur de la langue française, entouré de nombreux personnages secondaires parmi lesquels Samuel Beauregard, le responsable de l’accident, Cécile, la fille d’Antoine, et René, le père de Samuel.
« Retraité actif, Antoine était un grand homme élégant, à la chevelure abondante, striée de gris. Il avait dépassé de huit ans la soixantaine.
Natif de Memramcook, il avait commencé des études classiques à l’Université Saint-Joseph, où les professeurs se faisaient fort d’offrir aux étudiants un enseignement de haut niveau tout en accordant une place de choix à la qualité du français, ce qu’Antoine appréciait parce que pour rien au monde, il n’aurait voulu s’exprimer en chiac. » (p. 9-10)
« Même de loin, même blessé, Samuel Beauregard avait une apparence séduisante qui ne lui avait pas échappé. Elle l’avait vu debout en train d’attraper le déambulateur qu’une infirmière lui tendait : grand, mince, musclé, une trentaine d’années. » (p. 67-68)
« Un profil d’une délicatesse exquise, une chevelure rousse et bouclée qui virevoltait gaiement, des yeux verts pétillant d’excitation… une beauté délicate, régulière, parfaite, à la peau diaphane, à la voix enchanteresse; une beauté aux allures de bohème tout comme ses vêtements noirs un peu informes. […] Une dame tellement attrayante qu’elle avait suscité son admiration. S’il avait rêvé, il souhaitait que "ce rêve" ne s’arrête pas à sa porte, mais qu’il entre dans sa chambre sur la pointe des pieds… » (p. 79)
« Il ne parvenait pas à y croire : en discutant avec monsieur LeBlanc, lui, René Beauregard, avait prononcé des paroles bienveillantes et valorisantes à l’égard de son fils. Sa fibre paternelle avait vibré… jusqu’à aujourd’hui, il ignorait qu’il en avait une. » (p. 109)
- Intrigue de style feuilleton télévisé progressant grâce au cheminement des personnages, qui prennent conscience de leurs problèmes et tentent de les résoudre.
« À l’hôpital Georges-Dumont, Samuel, confiné dans sa chambre, se sentait bien seul. Des souvenirs cauchemardesques se bousculaient dans sa tête.
Il se revoyait en Asie où il habitait depuis onze ans. Pourtant, après tant d’années, il croyait avoir assumé cette tranche-là de sa vie… » (p. 57)
« Il voulait à tout prix tirer au clair ce qui l’avait ainsi secoué. Il n’avait pas l’habitude de se laisser aller à pleurer… Par principe, il avait constamment refusé de se plaindre, de montrer son désarroi. Pendant les années difficiles qu’il avait traversées, il s’était strictement interdit les explosions de colère, comme les crises de larmes, persuadé que son devoir était d’afficher une façade forte et impassible. Bien souvent, par orgueil, il s’était drapé dans sa dignité et avait gardé bonne contenance. Il avait encaissé encore et encore jusqu’au jour où Samuel était revenu dans le décor. » (p. 112)
« – La vérité, Jacques? C’est que j’ai eu peur de partir. Peur de me retrouver seule, peur que tu m’oublies, peur de me tromper, de prendre des risques, de donner sans recevoir. Peur de l’inconnu. La peur affecte le jugement et limite la liberté. J’en étais prisonnière, Jacques. Le recul m’a permis de voir clair. Je ne veux plus céder à la peur. Aujourd’hui, je me sens libre de l’intérieur et j’ai fermement l’intention de le rester. » (p. 173)
- Narrateur omniscient; séquences descriptives et dialoguées précisant le temps ainsi que le lieu de l’action et permettant de mieux connaître les personnages et de s’immiscer dans leur esprit et leur imaginaire.
« L’énorme boule de feu prenait d’assaut la chambre d’Antoine. Il se leva, s’étira en bâillant puis soupira d’aise… Tous les éléments étaient réunis pour sa marche quotidienne. Ce soleil promettait une journée parfaite! Du moins, le croyait-il. » (p. 9)
« Penser à la dégustation d’un tendre et succulent homard le fit saliver. Rebecca et lui en avaient mangé plus d’un, particulièrement pendant le célèbre Festival du homard. Il pouvait encore sentir rouler sous ses pieds le sable doré des plus belles plages d’eau salée de l’impressionnante côte est du Nouveau-Brunswick. Des bateaux de plaisance et des planches à voile voguaient doucement sur l’eau pendant que le soleil et le vent lui hâlaient la peau. Shédiac… de doux souvenirs! » (p. 63)
« – C’est le fait de prendre ta retraite qui te met dans un état pareil, René?
– Peut-être. La retraite, le centenaire de ma mère, les retrouvailles de Samuel… c’est comme si tous ces événements se sont ligués pour réveiller les blessures de mon passé.
– Voyons, René, à ton âge, tu peux faire la différence entre hier et aujourd’hui. Le passé est derrière toi. Inutile de t’y cramponner. Trinque plutôt aux belles années qu’il te reste et laisse le passé où il est.
– Encore faut-il l’avoir assumé, Martin. » (p. 113)
- Action suivant l’ordre chronologique, mais comptant plusieurs digressions (p. ex., analepse, télescopage, prolepse).
« Le mot père l’avait ramené à de vieux souvenirs : le déménagement imposé par celui-ci au début de son adolescence… souvenirs qui remuaient beaucoup d’émotions et même un peu d’animosité. […]
Quitter Shédiac, c’était se séparer de sa mamie adorée, celle qui avait été la mère qu’il n’avait jamais connue.
C’était aussi et surtout se séparer de Rebecca, sa petite amie de cœur avec qui il nageait en plein bonheur. Il passait presque tous ses week-ends et plusieurs heures par semaine avec elle, après la classe. » (p. 36-37)
« Son mandat terminé, René Beauregard revint à Shédiac et selon sa coutume, se consacra entièrement à son travail, laissant son fils se débattre avec ses études, ses combats, ses épreuves et son deuil.
***
Après sa première blessure amoureuse et quelques années d’errance, Samuel avait bien eu un certain nombre d’aventures, mais un sentiment de solitude intense continuait de l’envahir, même le corps plongé dans celui d’une autre. » (p. 61)
« Chemin faisant…, voyons le paysage intérieur de nos personnages, un an plus tard. » (p. 189)