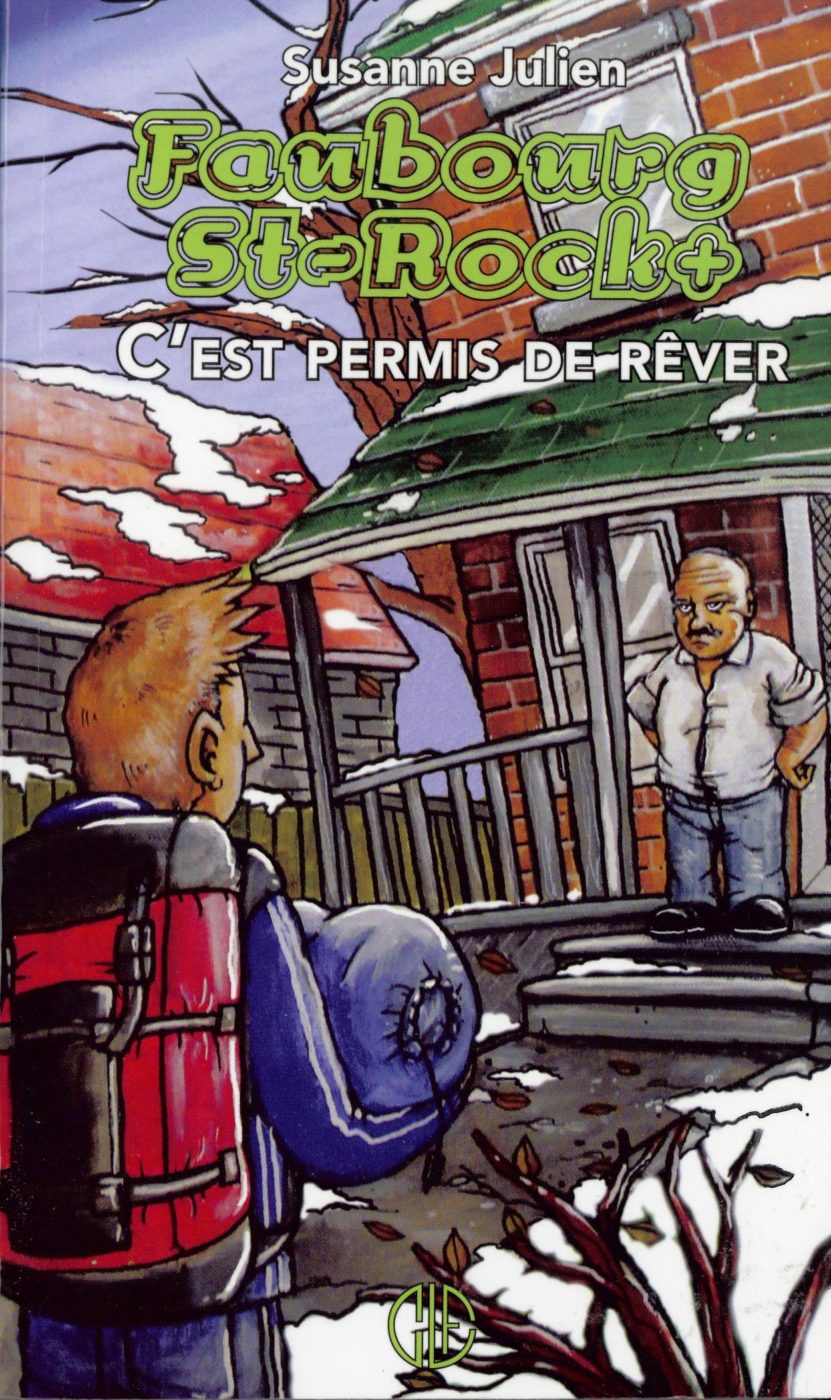- Registre de langue parfois courant, parfois familier dans les séquences narratives; langue parlée quelquefois familière, voire populaire dans le discours des jeunes et de certains adultes irritables ou acariâtres.
« Maxime se secoue. Ça ne l’avance à rien de se tourmenter ainsi. Il s’efforce de faire le vide dans son esprit pendant qu’il porte jusqu’à une voiture la commande de la dernière cliente de la soirée. La femme le gratifie d’un maigre pourboire. » (p. 10)
« Benoît, concentré sur sa tâche, remet de l’ordre sur les tablettes avant la fermeture du petit commerce familial. Le jeudi soir, les affaires sont bonnes et les clients, en farfouillant à la recherche de l’objet désiré, déplacent tout. » (p. 15)
« – Ça paraît qu’ils finissent cette année! s’exclame Caro. Ils sont stressants avec leur choix de cours pour le cégep. Tu devrais les entendre : "Moi, je ne vais pas à tel collège, parce que c’est trop nerd. Je préfère l’autre cégep, ça bouge plus là-bas […]" Ils sont supposés être plus vieux et plus fins, mais ils ont juste l’air plus twit. » (p. 32)
« – […] Les flos qui se prennent pour d’autres, j’en ai déjà cassé plusieurs. Tu veux jouer dur? Je peux l’être plus que toi. Ici, tu prends ton trou et tu n’écœures personne. Enlève tes bottes et attends que je te dise où t’installer. » (p. 43)
- Champs lexicaux et sémantiques liés aux thèmes ciblés (p. ex., culpabilité, impuissance, questionnement au sujet de la vie et de la mort, espoir).
« Assis au milieu de tous ces gens, Benoît reste prostré […] Un insoutenable mea-culpa retentit dans sa poitrine. Par ma faute, par ma très grande faute…
"Si seulement je l’avais écouté. Ce que je peux être idiot, épais! J’avais juste à barrer la porte." » (p. 37)
« Il a oublié le nom de la travailleuse sociale, sa sœur vit dans un endroit tout à fait inconnu de lui, il ignore quand il la reverra et où ils passeront le reste de leur vie. Le contrôle de la situation lui échappe totalement. Il a l’impression d’être enfermé dans une cage sur un bateau à dérive. Il ne possède aucun moyen de mener sa barque. Ça le déboussole et l’irrite. » (p. 47-48)
« Benoît se sent écrasé. Par la vie, dure et implacable, qui ne laisse aucune porte de sortie. Par sa vie, à laquelle il ne parvient pas à donner un sens. Par la mort, sournoise, qui attend dans un détour. Depuis quatre jours, il ne pense qu’à ça. Il tourne et retourne des idées noires dans sa tête. Un ouragan de sombres pensées aussi violent que la tempête de neige qui l’entoure. » (p. 66)
« …Max ne peut admettre que quelqu’un puisse s’intéresser à lui. Mais il n’a pas rêvé : ce matin, trois personnes se sont souciées de lui. […] Et venant de Caroline, c’est incompréhensible. Est-ce qu’elle éprouverait plus que de la compassion pour lui? Son esprit logique répond non, mais il souhaite le contraire sans se l’avouer. » (p. 164)
- Figures de style nombreuses et variées (p. ex., comparaison, personnification, métonymie, métaphore, litote, hyperbole, répétition, gradation), traduisant la propension des jeunes à l’introspection et à l’exagération.
« Quand les professeurs enseignent, ça lui traverse le cerveau sans s’arrêter. Parfois il ne les écoute pas du tout. Leurs paroles coulent sur lui comme l’eau sur le dos d’un canard. Il devient incapable de se concentrer sur quoi que ce soit : plus rien ne parvient à s’agripper à sa mémoire. » (p. 8)
« Mais la voiture n’obéit pas immédiatement. Après une longue glissade, elle s’immobilise enfin. […]
– Ouais! La piste Gilles Villeneuve, ce n’est pas pour demain! Tu as encore plusieurs fonds de culotte à user, assis sur ton siège à t’exercer. » (p. 75)
« – […] Ce n’est pas ma sœur qui se serait chargée de nettoyer les jumeaux. Des monstres, ces bébés-là! Et ne me dis pas qu’ils sentent bon. Tu viendras leur laver les fesses. » (p. 83)
« Catastrophe! Il aurait déclenché la Troisième Guerre mondiale, ça n’aurait pas été pire. Il avait osé toucher aux petites culottes et aux soutiens-gorge de madame! Et dans quel état les avait-il mis! En petites boules! C’est tout un art que de plier des dessous féminins. » (p. 98)
« – Faire des bébés à 40 ans, ça n’a aucun sens! Des pas d’allure, mes parents. […] Tannée, tannée, tannée! Je vais m’acheter des bouchons de cire. Non, des cierges, des lampions pour me boucher les oreilles. Je ne les entendrai plus. Je n’entendrai plus rien. » (p. 109)